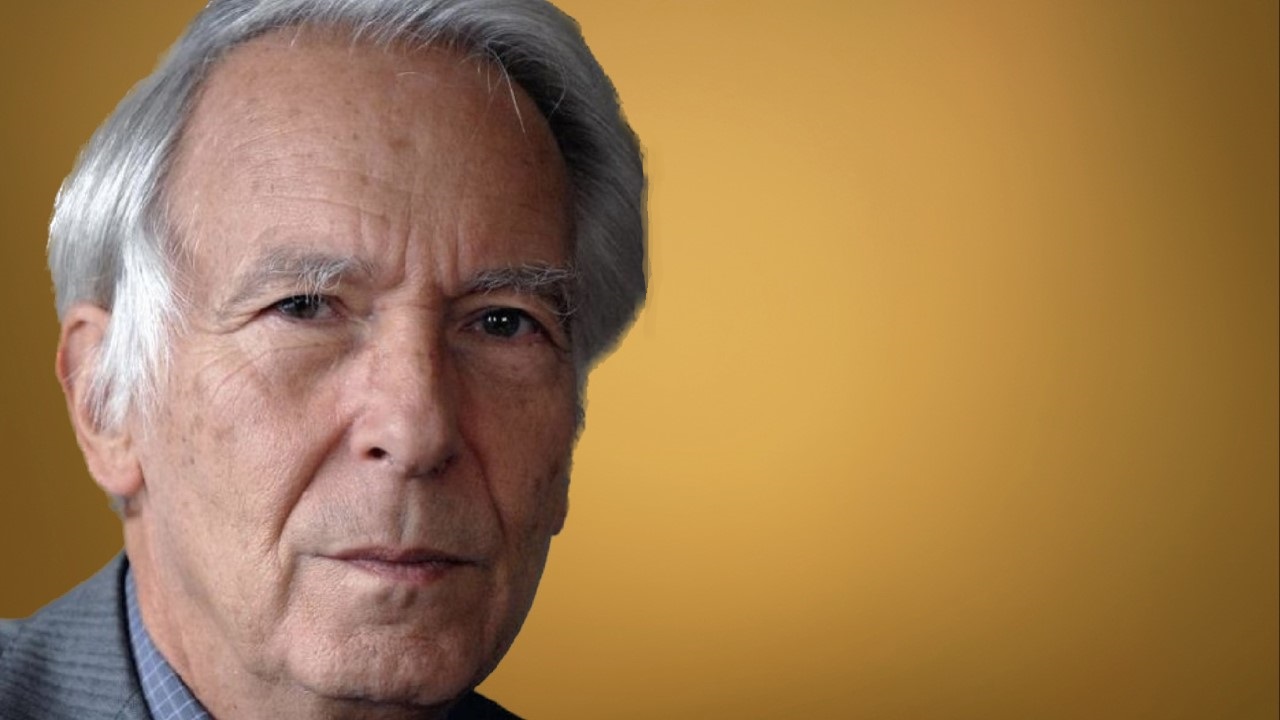Polytechnicien, ingénieur des Mines et directeur de recherche au CNRS, Philippe d’Iribarne est l’auteur d’une oeuvre qui dévoile la façon singulière dont les Français envisagent le travail en obéissant, selon lui, à une “logique de l’honneur”. Dans Le Grand déclassement (1), son dernier ouvrage, il défend l’idée que, loin de représenter une fatalité, l’actuel mal-être au travail proviendrait de pratiques managériales inadaptées provoquant un sentiment croissant de déchéance et de perte de sens.
Certains interprètent le refus assez massif du projet de report de l’âge de la retraite comme un nouveau signe que nos compatriotes n’aiment plus le travail… Qu’en pensez-vous ?
Il faut d’abord souligner que les réactions sont quand même diverses par rapport à ce projet et qu’il n’est donc pas possible d’en déduire une conclusion homogène concernant tous les Français. Alors, c’est vrai que certains commentateurs se laissent aller à considérer que ce rejet de la réforme révélerait que les Français sont de plus en plus paresseux. Cela ne me semble pas correspondre à la réalité car, de nombreuses enquêtes démontrent au contraire que les Français restent très attachés au travail et à la “valeur travail”. En revanche, nombre de nos compatriotes vivent douloureusement le décalage existant entre ce qui leur paraît un travail dans lequel cela vaut la peine de s’engager et ce qui leur est désormais proposé par un très grand nombre d’entreprises, et tout spécialement par les grandes entreprises.
D’ailleurs, parmi les personnes qui prennent leur distance avec leur travail, une part substantielle s’investit aussitôt dans des activités associatives, caritatives ou autres, avec beaucoup d’énergie, de sérieux et même de professionnalisme. Ce mouvement dément la prétendue revendication par nos compatriotes d’un illusoire “droit à paresse” ou d’une quelconque tendance à la fainéantise. En revanche, il alerte sur le fait qu’un nombre croissant de personnes, y compris parmi les plus dynamiques, recherchent dans d’autres activités des gratifications qu’elles ne trouvent plus, ou plus suffisamment, dans ce que l’on appelle officiellement un travail : la fierté d’accomplir quelque chose d’utile, la possibilité de mobiliser leurs compétences, etc. Les Français sont donc tout à fait disposés à se donner de la peine pour obtenir un résultat mais, dans leur travail rémunéré, ils ont souvent le sentiment que le résultat obtenu n’est pas à la hauteur des efforts consentis.
Une étude pilotée par la sociologue Dominique Méda a établi qu’en Europe, les Français se distinguent par un attachement particulièrement fort au travail, notamment par rapport aux Allemands, mais que, en retour, “leurs attentes sont extrêmement fortes en matière de réalisation et d’expression de soi dans le travail”. Partagez-vous ces conclusions ?
Oui, car plusieurs études ont souligné qu’en Allemagne, ce qui importe avant tout aux travailleurs, c’est d’effectuer une tâche utile mais que, en revanche, leurs attentes en termes de réalisation de soi et de participation à une œuvre sont bien moindres qu’en France. Les Français, dès que leur travail les intéresse, dès qu’ils considèrent qu’il en vaut la peine, sont capables d’y investir énormément d’eux-mêmes. Cela s’explique par le fait que, dans notre pays, le travail représente un élément central de l’identité des individus. Même les conversations courantes en témoignent. Dans d’autres pays, comme les États-Unis, lorsque l’on fait connaissance avec une personne, on s’enquiert volontiers de l’Église à laquelle elle appartient et l’on n’hésite pas à faire état de son niveau de revenu. En France, très rapidement, on demande : “Que faites-vous dans la vie ?” Il y a, dans notre pays, un lien intime, entre le travail que l’on fait, le métier que l’on exerce et la place que l’on occupe dans la société. Le travail a, chez nous, une dimension existentielle, identitaire et affective qui explique qu’il déchaîne plus qu’ailleurs les passions. Ce n’est d’ailleurs pas neutre du tout en termes de risques psychosociaux. En effet, les Français supportent beaucoup moins que d’autres d’être malheureux au travail car, justement, le travail contribue, de façon prépondérante, à l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes.
Comment expliquez-vous ce rapport particulier des Français au travail ?
La société française contemporaine reste héritière de la société aristocratique d’ancien régime, si bien que nos mentalités sont hantées par la question du rang. C’est une société dans laquelle les droits et les devoirs que l’on a sont intimement liés à une position sociale. Contrairement à ce que l’on croit, cela a perduré après la Révolution française, mais sous une forme différente. En France, la question du travail est fortement liée à celle du statut social. Comme je l’ai expliqué dans mon ouvrage La logique de l’honneur, le rapport des Français au travail est marqué par une tension – et une conciliation originale – entre l’héritage aristocratique et l’aspiration égalitaire.
En effet, les Lumières et la Révolution française n’ont pas effacé le souci du rang mais l’ont généralisé en faisant émerger une multitude d’aristocraties fondées sur les vertus et les talents, ce qui explique notamment l’importance que revêt, dans notre pays, le diplôme. Dans le monde du travail, cela s’est notamment traduit par l’émergence, dès le XIXe siècle, d’une “aristocratie ouvrière” ou, dans les années trente, de la catégorie des cadres directement inspirée de celle de l’officier, avec tout ce que cela implique en termes de rang et de rôle social. On pourrait aussi évoquer le cas des professions libérales qui tiennent à affirmer une identité distincte de celles des salariés pour affirmer leur souveraineté professionnelle. Mais pour tous les travailleurs la question centrale est celle de la dignité qui s’attache à une certaine forme de liberté. Ainsi, même au sein des professions salariées, il est important, pour les travailleurs, de pouvoir considérer qu’ils n’obéissent pas seulement aux injonctions d’un patron mais à des règles de l’art ou aux devoirs d’un métier si bien qu’ils ne sont pas vraiment dépendants.
Cette vision du travail n’explique-t-elle pas aussi l’attachement des Français à cette version contemporaine des privilèges que sont les “droits acquis” ?
Les droits acquis sont liés, dans l’imaginaire français, à l’idée de conquête : ils ont été “conquis” et non pas “octroyés”. Dès lors, renoncer à tel ou tel de ces droits est aisément vécu comme une défaite, une humiliation. Cela explique bien sûr la nature volontiers conflictuelle que prennent, dans notre pays, les relations sociales. Cela dit, cet attachement sourcilleux au statut n’a pas que des aspects négatifs. En effet, le point commun des différentes “aristocraties professionnelles” est aussi l’attachement au métier et à la dignité que confère le travail bien fait. Dans ce système, l’amour-propre et l’amour du travail bien fait se confondent. Cela s’observe évidemment avec une intensité différente selon les professions et les circonstances mais reste quand même très vif dans de nombreux corps de métier.
Pour ne prendre qu’un exemple, il est frappant de constater que, lorsque des tempêtes mettent à mal le réseau électrique, les mêmes agents d’EDF si viscéralement attachés à leurs droits acquis, sont capables d’un admirable dévouement parce qu’ils mettent un point d’honneur à rétablir le service le plus rapidement possible. Il ne faut donc pas s’y tromper : le souci français du statut ne se résume pas aux privilèges qui y sont attachés. Il exprime aussi une vision exigeante du travail. La logique de l’honneur implique en effet que chacun se montre à la hauteur de son métier et de sa mission. Comme l’a souligné Montesquieu, l’honneur ne conduit pas seulement au refus d’être traité d’une manière indigne de la position que l’on occupe dans la société mais aussi à l’exigence de se montrer digne de celle-ci. Pour obtenir qu’un travailleur français aime son travail et s’engage dans celui-ci, il faut donc respecter son désir de bien le faire, lui donner l’occasion d’être fier de ce qu’il accomplit et lui reconnaître une forme de souveraineté dans son domaine de compétence. Ce n’est pas pour rien que “le travail empêché” est l’une des principales sources de souffrance au travail.
Quels sont, concrètement, les facteurs qui contribuent, dans la vie professionnelle, au “grand déclassement” que vous décrivez ?
Le premier facteur est à mon sens la très forte réduction des marges de manœuvre dont jouissent de nombreux professionnels. Or, dans la mentalité française, cette question prend une acuité particulière car elle recoupe la distinction fondamentale entre l’homme libre et le serf. Lors des manifestations contre le Contrat première embauche (CPE), on a ainsi vu la littérature syndicale s’insurger contre un projet visant, selon elle, à rendre les travailleurs “taillables et corvéables à merci”, ce qui est la définition même de la position du serf dans la société d’ancien régime ! Le premier critère du déclassement est ainsi de savoir si l’on est un homme libre ou un simple exécutant. L’homme libre est, dans le travail, celui qui maîtrise les règles de l’art de son métier, qui les comprend et qui les interprète.
Or, au cours des dernières décennies, le monde du travail a subi une profonde évolution se traduisant par une prolifération des procédures, des indicateurs, des règles qui a conduit de plus en plus de travailleurs à considérer qu’ils n’ étaient que des exécutants. Il y a, dans le travail contemporain, une barrière symbolique très forte séparant un nombre de plus en plus réduit de dirigeants qui conçoivent, créent et inventent, et un nombre de plus en plus important de travailleurs qui se sentent rabaissés au rang de simples exécutants parce que leurs marges de manœuvre se réduisent comme peau de chagrin. Cette situation est vécue très douloureusement et est, à mon sens, l’une des principales sources du mal-être au travail.
Cette distinction entre concepteurs et exécutants recoupe cependant une certaine nécessité dans l’organisation du travail. Tout le monde ne peut pas être chef…
Bien sûr ! L’important est que, même les travailleurs occupant des positions subalternes aient le sentiment de participer, par leurs compétences propres, à une œuvre. Les Français ont besoin que leurs tâches quotidiennes s’inscrivent dans un dessein plus grand et que leurs réalisations soient reconnues, sinon par le plus grand nombre, au moins par leurs pairs. C’est l’idée du chef-d’œuvre magnifiée par les bien nommés Compagnons du devoir. Peu importe d’ailleurs la tâche concernée. Il peut aussi bien s’agir de soigner des malades que de concevoir un nouveau produit, de construire un bâtiment, de réparer une voiture ou d’élaborer un plat, un menu… L’essentiel est que cette tâche mobilise leur intelligence, leur créativité et leur savoir-faire. Or, cette aspiration est aujourd’hui contrariée par la standardisation des métiers, la multiplication de normes tatillonnes et de process rigides qui rognent impitoyablement les marges de manœuvre des travailleurs. Les salariés désenchantés expriment très clairement ce sentiment de dépossession. Ils disent n’en plus pouvoir d’être traités comme des “robots”, des “machines”, des “pions”…
J’ajoute que ce sentiment d’appauvrissement du métier ne concerne pas que les travailleurs subalternes ni même les seuls salariés. Pour ne prendre qu’un exemple, les médecins soumis à la tutelle de plus en plus vétilleuse des Agences régionales de santé (ARS) et redoutant de devenir progressivement de simples exécutants au service de la Sécurité sociale vivent également très douloureusement cette évolution de leur métier. Lorsqu’ils défendent bec et ongles le paiement à l’acte, c’est aussi leur statut de profession libérale qu’ils défendent et une certaine idée de leur dignité professionnelle. On pourrait probablement en dire autant des professeurs qui ont le sentiment de ne plus être maîtres en leur classe…
N’est-ce pas aussi le cas des cadres ?
En effet, car en raison d’une multitude de mutations organisationnelles et managériales, beaucoup de cadres constatent avec amertume qu’ils ne sont plus réellement partie prenante aux décisions importantes de l’entreprise. Autrefois, même dans les grandes firmes, la plupart des cadres se sentaient proches de la direction alors que désormais, ils sont nombreux à considérer qu’ils sont plutôt du même côté du manche que leurs subalternes, c’est-à-dire du côté des exécutants. D’ailleurs, pour retrouver des marges de manoeuvre et un métier plus gratifiant, un nombre significatif de diplômés des grandes écoles pouvant prétendre à des postes de hauts cadres dans de grandes entreprises décident de choisir une autre voie. Parmi les polytechniciens sortis de l’École en 2018 et recrutés dans une entreprise, 27 % l’ont été par une PME de moins de 50 salariés et certains ont même décidé de créer leur propre entreprise, confirmant ainsi que, malgré les niveaux de rémunération qu’elles offrent à ce type de profil, les grandes firmes ne leur semblent plus aussi attractives qu’auparavant.
Justement, les entrepreneurs, les dirigeants de TPE et PME sont-ils, de leur côté, épargnés par ce sentiment de déclassement ?
Les créateurs et dirigeants d’entreprise bénéficient évidemment, par nature, d’une plus grande autonomie que les travailleurs salariés. Souvent, la création d’entreprise répond d’ailleurs à un désir de liberté. L’expression “devenir son propre patron” exprime parfaitement cette espérance d’un gain de liberté. Toutefois, je ne suis pas persuadé qu’elle soit toujours satisfaite parce que les chefs d’entreprise eux-mêmes sont soumis à un nombre croissant de normes et de règles de plus en plus contraignantes qui les entravent dans leur aspiration à agir et à créer, sans compter la place croissante prise par les obligations administratives… La multiplication des normes et des obligations administratives génère un sentiment de perte de liberté voire de perte d’identité professionnelle. À l’occasion d’une enquête parlementaire un entrepreneur agricole témoignait : “On ne vit plus de notre métier qui est de vendre du lait ou de la viande à leur juste valeur. Nos revenus existent avec la PAC, les MAEC, les PCAE, etc. Mais la contrepartie c’est de la paperasserie de plus en plus compliquée et des sanctions possibles”. Et il concluait : “Il serait indispensable que l’agriculteur demeure le décideur de son avenir et de sa ferme”. De son côté, Olivier Torrès, professeur à l’université de Montpellier et spécialiste de la souffrance professionnelle des entrepreneurs, a mis en évidence que les dirigeants d’entreprise souffraient d’un “syndrome d’empêchement”. Alors que la valeur cardinale de l’entreprenariat est la créativité, notre société est saisie par une sorte de passion pour la conformité. Cela crée évidemment beaucoup de frustration.
Pour résoudre la question du mal-être au travail, de nombreux décideurs et cabinets de conseil mettent en avant la nécessité de remettre du sens au travail. Qu’en pensez-vous ?
Se saisir de la question du sens au travail est tout à fait pertinent et même indispensable. Mais encore faut-il savoir de quoi l’on parle ! Je suis persuadé que la question du sens ne peut être résolue qu’en partant des aspirations réelles des membres de l’entreprise. Il faut partir de ce qui est, de ce qui est ressenti et vécu par les travailleurs concernés. Je veux dire par là qu’à rebours d’une préconisation souvent mise en avant, il est parfaitement illusoire d’espérer résoudre la perte de sens des travailleurs en mettant simplement en avant une mission vertueuse de l’entreprise, voire en se dotant d’un statut d’entreprise à mission formalisant son engagement dans une grande cause, évidemment pétrie de bons sentiments. Ne nous méprenons pas : bien évidemment, tout le monde préfère travailler dans une entreprise vertueuse, par exemple soucieuse de préserver l’environnement. Mais, quand bien même cet engagement serait sincère – ce qu’il faudra du reste démontrer à des Français volontiers sceptiques et caustiques -, il passerait à côté ou plutôt au-dessus des véritables enjeux de sens au travail. En effet, le sens au travail dépend au moins autant de ce que l’on fait, là où l’on est, concrètement, dans sa tâche propre, que de ce que l’entreprise et les grands chefs affichent. Une entreprise bureaucratique étouffant ses salariés sous les normes peut bien vouloir sauver la planète, elle n’en restera pas moins une entreprise bureaucratique étouffante pour ses salariés !
Quel conseil donneriez-vous aux chefs d’entreprise pour conjurer ce sentiment de grand déclassement ?
Le premier conseil que je leur donnerais est de retrouver des marges de manœuvre en se libérant, autant que possible, des tâches et des servitudes qui ne relèvent pas directement de leur rôle de dirigeant. Je pense bien sûr aux obligations administratives, à tout ce qui relève de la fameuse “paperasse”, et qui peut être confié à des personnes compétentes aussi bien en interne qu’en externe. Lorsqu’ils en ont la possibilité, les patrons devraient déléguer davantage en faisant appel à des prestataires et des intervenants extérieurs, pour se faire aider par des spécialistes dans les tâches les plus fastidieuses et les plus rébarbatives de façon à retrouver plus de temps pour les missions qui leur incombent vraiment, dans lesquelles ils ont une authentique valeur ajoutée et qui correspondent à leur authentique raison d’être.
Et à l’égard de leurs salariés, que peuvent-ils faire pour conjurer la souffrance professionnelle et le sentiment de déclassement ?
La bonne méthode pour retrouver du sens et même une forme de bonheur au travail consiste à réintroduire, à tous les échelons de l’entreprise, des marges de manœuvre, des capacités d’initiatives, de démultiplier les occasions, pour les salariés, de mobiliser leurs connaissances, leurs compétences et leurs talents afin de retrouver ainsi la fierté du travail réalisé. Certaines entreprises ont accompli cette mue. Je pense notamment au cas de Michelin qui, après avoir adopté, en 2010-2011, un virage très procédurier, importé des États-Unis, a effectué à virage à 180° en posant cette simple question à un ensemble d’îlots de fabrication : “De quoi seriez-vous capables, en termes de décision, sans intervention des agents de maîtrise, en termes de résolution de problèmes, sans dépendre des maintenanciers ni des régleurs, techniciens et autres organisateurs industriels ? Et à quelles conditions ?” À partir des réponses recueillies, l’entreprise a lancé des expérimentations, puis une transformation générale de l’organisation dans une perspective de responsabilisation et de confiance à tous les niveaux en partant de la base. Je crois que cet exemple est très inspirant, y compris pour les entreprises de taille beaucoup plus modestes car, de la sorte, Michelin n’a rien fait d’autre que réintroduire, en son sein, un mode de fonctionnement très proche de celui que pratiquent spontanément nombre de TPE et de PME ! Mon conseil aux dirigeants de ces entreprises serait donc de ne pas se laisser impressionner par les modes managériales adoptées par les grandes entreprises, de se prémunir des dérives procédurières qui ont calcifié celles-ci et de cultiver la confiance mutuelle qui a toujours été leur plus grand atout.
Propos recueillis Christophe Blanc
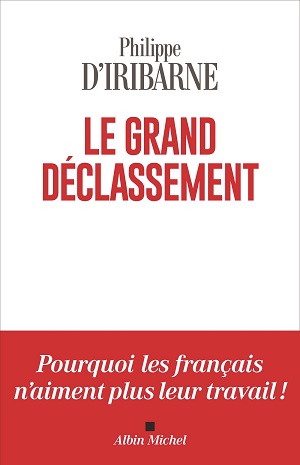
(1) Le Grand déclassement, par Philippe d’Iribarne, Albin Michel, septembre 2022, 176 p., 19,90 €
Philippe d’Iribarne est ancien élève de l’École polytechnique, diplômé de l’IEP de Paris, ingénieur général du Corps des mines et directeur de recherche au CNRS. Il dirige, depuis 1972, le centre de recherche “Gestion et société”. Il a publié différents ouvrages explorant la façon dont les cultures nationales influent sur le fonctionnement des organisations et des sociétés, tels que La Logique de l’honneur (Le Seuil, 1989), L’Étrangeté française (Le Seuil, 2006), L’épreuve des différences (Le Seuil, 2009) ou encore L’Envers du moderne (CNRS Éditions, 2012). Il est également l’auteur de divers ouvrages sur les dilemmes que posent à la société française, universaliste et assimilatrice, les questions religieuses et identitaires : Les Immigrés de la République. Impasse du multiculturalisme (Le Seuil, 2010), L’Islam devant la démocratie (Gallimard, 2013), Islamophobie. Intoxication idéologique (Albin Michel, 2019). Il vient de publier Le Grand déclassement (Albin Michel, 2022).