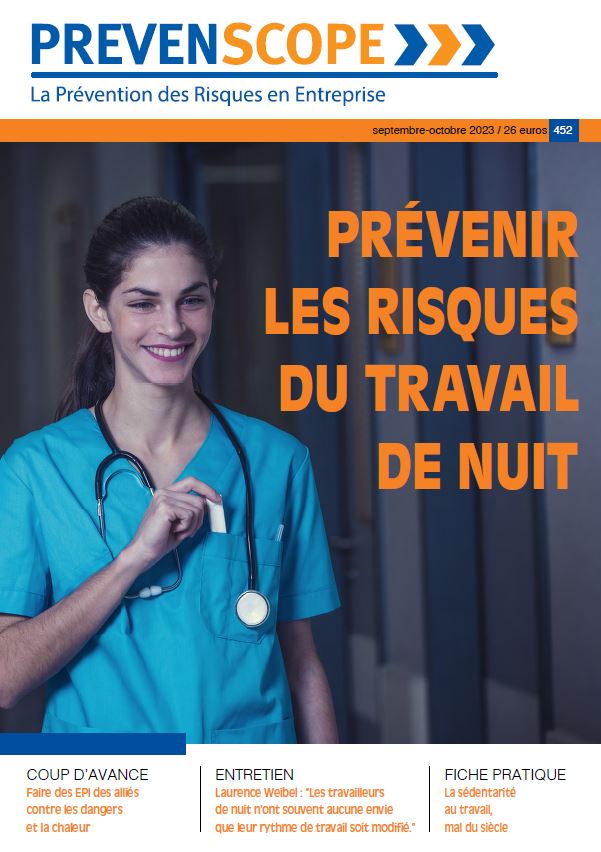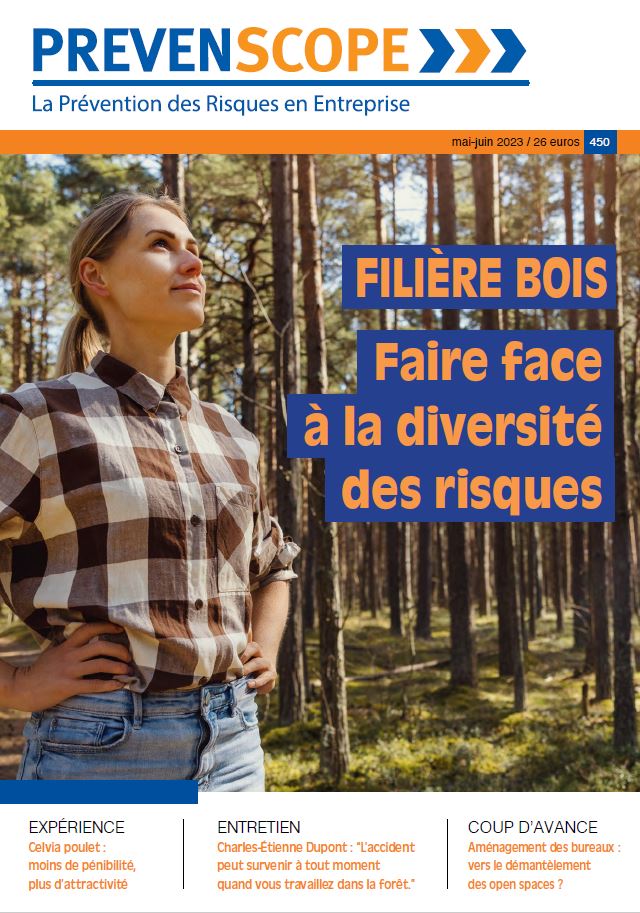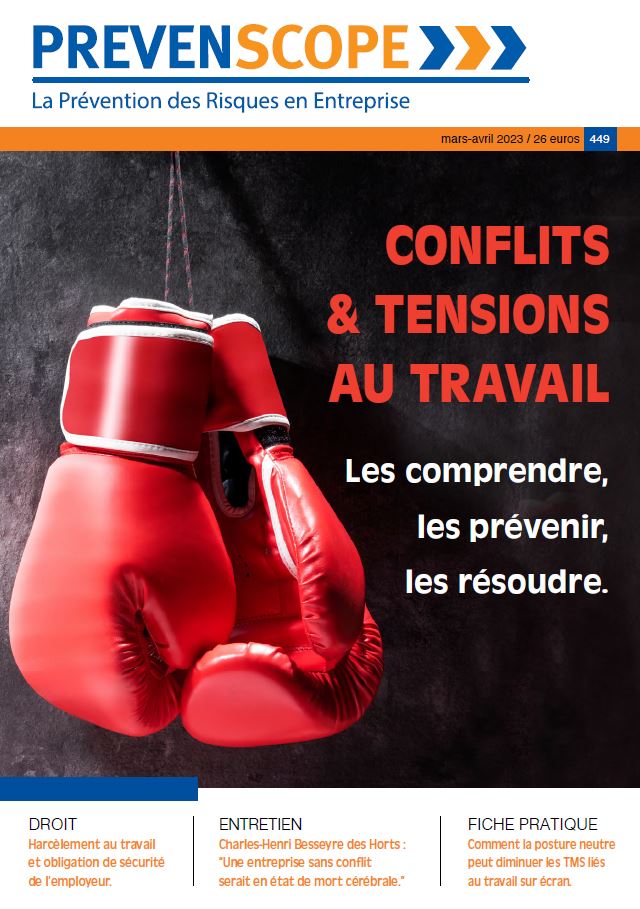Avec un peu plus de 5 000 adhérents, essentiellement des artisans, répartis sur tout le territoire français, la Fédération nationale de l’automobile (FNA) est l’une des principales organisations professionnelles représentatives des TPE des métiers de l’automobile. Secrétaire générale adjointe de la fédération, en charge du suivi des métiers, Émilie Repusseau note une meilleure prise en compte des questions de sécurité et de santé des salariés, par les chefs d’entreprise qui ne connaissent pas toujours les aides dont ils peuvent pourtant bénéficier pour concrétiser des actions efficaces de prévention.
.
Les entrepreneurs de la branche des métiers de l’automobile sont-ils conscients de leurs obligations et de leurs responsabilités lorsqu’ils lancent leur activité ?
95% des entreprises du secteur sont des TPE de moins de 11 salariés et près de 7 sur 10 d’entre elles comptent même moins de 5 salariés, il s’agit donc de très petites structures, familiales le plus souvent. Sans préventeur ou poste RH, c’est souvent l’entrepreneur lui-même, avec l’aide de son conjoint parfois, qui assure l’ensemble des obligations liées au fonctionnement de l’entreprise.
Ces professionnels sont des artisans qui ont, à la base, appris un métier concret, et qui endossent un rôle de chef d’entreprise en plus de leurs horaires de travail effectifs de carrossier par exemple. Ils ne sont pas réellement préparés à des futures fonctions administratives et chronophages liées à leur statut, qui va changer, notamment le jour où ils vont engager à leur côté un premier salarié. Le stage obligatoire de préparation à l’installation et au pilotage de l’entreprise a été supprimé en 2018 par les pouvoirs publics par soucis d’économie.
Le plus souvent, ils ont conscience que leur responsabilité peut être engagée sur un plan civil ou pénal et plus généralement sur le plan administratif, mais c’est souvent l’ampleur des mesures administratives et des dispositifs à mettre en place qui peuvent les surprendre. À ce jour, aucune loi de simplification ne s’est traduite par un allègement efficace.
Sont-ils néanmoins sensibilisés à la problématique de la sécurité et de la santé de leurs salariés ?
Oui, depuis longtemps, et ils le sont de plus en plus, en particulier depuis la crise sanitaire. Notre secteur ayant fait partie des secteurs dits essentiels, les garages sont restés ouverts mais avec la mise en place de protocoles de sécurité rigoureux. Cette situation a fortement impacté la notion de prise en compte des risques dans les entreprises du secteur.
Aujourd’hui, l’obligation de disposer d’un document unique d’évaluation des risques professionnels est relativement bien assimilée mais la mise en oeuvre du plan d’actions, un peu moins. Or, le fait d’avoir ce document, y compris à jour, ne doit pas être une fin en soi. Trop souvent encore, les chefs d’entreprise répondent à cette obligation en oubliant que le document unique impose aussi une démarche volontaire de l’entreprise pour définir et mettre en oeuvre des mesures concrètes d’amélioration et de prévention de la sécurité des collaborateurs. Notre fédération agit pour que les TPE intègrent une vraie culture de prévention en associant également les salariés à chaque étape.
Quels sont les accompagnements nécessaires pour les patrons sur la voie de la prévention des risques ?
Concrètement, il existe beaucoup de moyens et d’outils afin de lutter contre les risques professionnels. De notre côté, par exemple, nous envoyons chaque semaine à nos adhérents une note d’informations sociales, juridiques et fiscales, dans laquelle le sujet de la prévention des risques est abordé d’une manière récurrente. La FNA dispose aussi d’un organisme de formation, le CFPA France. Il dispense des formations sur le risque routier dans le cadre des activités de dépannage et de remorquage mais également sur les gestes et postures ou la prise en charge des véhicules électriques qui sont de plus en plus nombreux sur la route. Les dépanneurs ou les carrossiers sont donc de plus en plus souvent susceptibles de devoir intervenir sur ce type de véhicule pour lequel le risque électrique est relativement important.
D’autres organismes sont susceptibles d’accompagner les chefs d’entreprise sur cette voie : l’INRS, les services de santé au travail, ou l’Assurance Maladie qui a, par exemple, créé des fiches de poste en partenariat avec les différentes fédérations, pour les activités de garage automobile et poids lourds sur les thèmes de la mécanique, de la tôlerie, de la peinture et sur l’utilisation d’un certain nombre d’équipements et autres outillages. Il en existe une quarantaine à ce jour.
L’Assurance Maladie propose aussi des aides financières qui peuvent être activées lors d’une installation de matériel ou pour procéder au renouvellement d’un équipement.
Quel est le processus pour bénéficier de ces aides ?
Nous avons signé une convention nationale d’objectifs avec l’Assurance Maladie, renouvelée tous les 4 ans, avec de vrais engagements en faveur des professionnels. Quand ils signent, par exemple, un contrat de prévention avec l’Assurance Maladie, nos adhérents peuvent bénéficier d’un accompagnement soutenu via leur Carsat. En effet, l’Assurance Maladie pilote le programme mais ce sont ensuite les Carsat, ou la Cramif en Île-de-France, qui vont concrétiser les aides et mobiliser les financements.
Des aides financières fléchées sur des risques professionnels existent également et leur montant est fixé action par action. Au niveau du secteur automobile, l’Assurance Maladie octroie des aides – sur les troubles musculosquelettiques, les postures ou les risques chimiques – qui peuvent atteindre 70 % d’un montant fixé par type d’aide. Si on imagine la nécessité d’un investissement de l’ordre de 25 000 €, dans le cadre d’un renouvellement d’équipements, cela peut donc représenter une part importante du financement. Bien sûr, il y a auparavant un contrôle pour identifier si l’équipement est bien éligible à l’aide. L’entreprise doit présenter son projet dans un document formalisé et un des préalables concerne le DUERP de l’entreprise qui doit être à jour.
Quels sont les risques concernés ?
L’automobile est considérée comme un secteur à risque et chaque Caisse peut cibler tel ou tel risque. C’est le cas des troubles musculosquelettiques. Des tables élévatrices ou des machines, en aidant à soulever des pneumatiques, permettent de limiter ces risques, mais des matériels plus anodins sont aussi concernés comme des valises d’outils. Ces dernières années sont aussi apparues des aides sur des équipements de captage d’émissions de CO2 dans les garages et dans les centres de contrôle technique, pour faire face aux risques de développer des cancers.
L’Assurance Maladie a également mis à la disposition des entreprises des tutoriels sur l’usage en toute sécurité de certains matériels, comme un pont élévateur. Ces accompagnements sont relativement récents mais ils sont très utiles pour procéder à un achat en connaissance de cause, en choisissant par exemple un équipement qui permettra d’alléger les postures des salariés qui l’utilisent. C’est une manière de mieux penser un poste de travail. Il y a encore quelques années, cette notion était inexistante dans les intentions d’achat ou de renouvellement des équipements.
Dans les petites entités, le patron est trop souvent corvéable à merci. Est-il conscient des propres risques pour sa santé ?
On parle très peu du bien-être du chef d’entreprise mais, pour sa propre santé, il faut trouver la bonne formule pour faire tourner son activité tout en acceptant de lever le pied de temps en temps. Mais en dehors de la réorganisation du travail, quand c’est possible, je ne suis pas sûre que le chef d’entreprise prenne davantage en compte sa santé. Dans le dépannage par exemple, ce sont parfois les patrons eux-mêmes qui travaillent le week-end pour ne pas avoir à solliciter leurs collaborateurs. C’est une réalité pour les chefs d’entreprise et leurs conjoints, dont les petites structures ne leur permettent pas une marge de manœuvre très importante dans ce domaine. Il y a donc beaucoup de stress, de manque de temps pour se poser et réfléchir à d’autres paramètres que ceux liés à l’activité elle-même.
Pourtant, la culture de la prévention des risques n’est-elle pas un paramètre important de la notion de qualité de vie au travail, donc de l’attractivité des métiers du secteur ?
Au-delà de la protection des salariés, la prévention des risques est également, en effet, un atout pour les entrepreneurs afin de fidéliser leurs collaborateurs dans un secteur sous tension où il y a 20 000 postes à pourvoir et d’assurer une attractivité auprès d’éventuelles recrues. D’où l’importance de la sensibilisation. Il est rassurant, pour eux, de comprendre que leur futur employeur est attentif à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs.
Pour les candidats à un poste dans le secteur, le critère salaire n’est plus forcément le plus important. Les questions liées à l’organisation et les horaires de travail font davantage la différence, y compris sur les postes nécessitant des astreintes, comme dans le dépannage que j’évoquais précédemment. Depuis 2020, on note aussi dans l’activité de réparation que de plus en plus d’entreprises ont choisi de fermer le samedi. C’est un argument de poids lorsqu’il s’agit de trouver de nouveaux collaborateurs bien décidés aujourd’hui à ne pas sacrifier leur vie de famille à leur activité professionnelle.
Propos recueillis
par Stéphane Chabrier