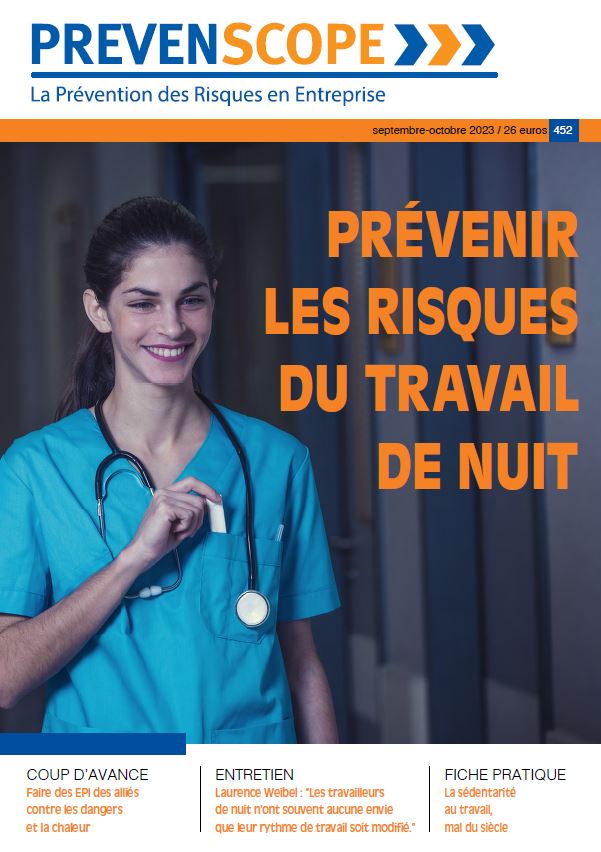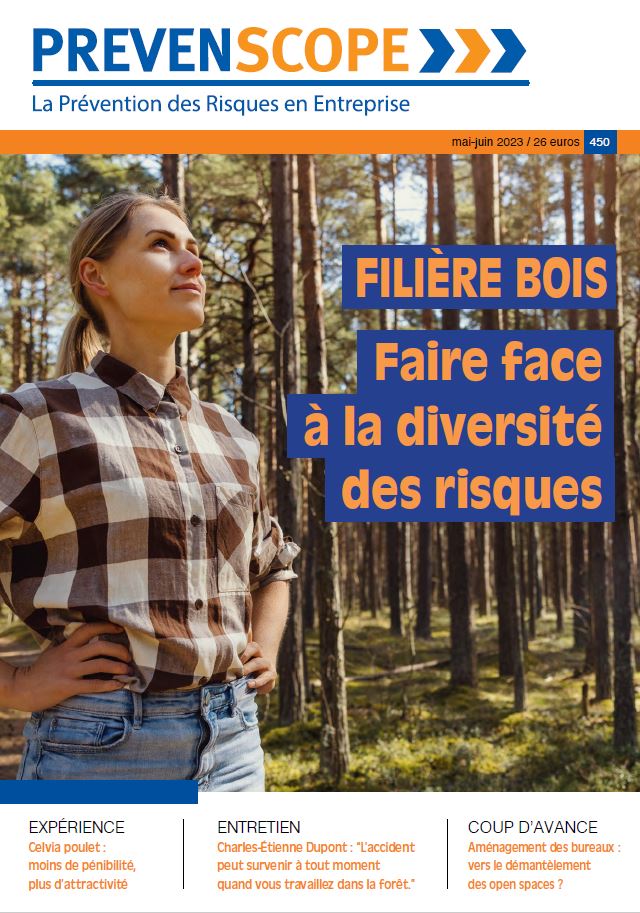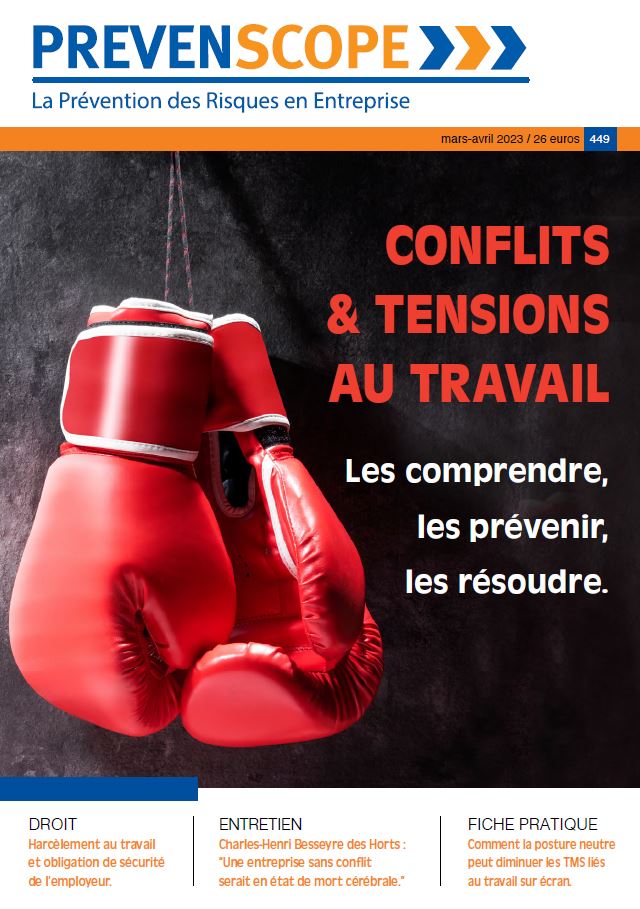Près de 140 000 entreprises sont liées, en France, aux services de l’automobile. Le secteur occupe ainsi 560 000 actifs, salariés et indépendants et pourtant 20 000 postes restent à pourvoir. Il est vrai qu’avec près de 50 millions de véhicules en circulation en France, ce secteur en pleine mutation a de quoi occuper ses salariés.
Selon, les chiffres du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, il y avait en 2023 près de 49 millions de véhicules en France. Ce parc est constitué pour plus de 77 % de voitures, les utilitaires légers représentants 12,7 % et les deux-roues motorisés 8,3 %. Les poids lourds, bus et cars représentent quant à eux 1,4 %.
Un secteur dynamique
Si l’évolution des immatriculations fluctue au gré de la santé économique du pays et d’autres divers facteurs (forte baisse des immatriculations de véhicules neufs en 2020, en raison de la crise sanitaire,
par exemple), la progression positive en volume de ce parc reste régulière, malgré un léger ralentissement enregistré depuis 2019. L’âge moyen du parc de véhicules légers atteint désormais 10,9 ans.
La première dépense liée à l’automobile ne concerne plus ni l’achat de véhicules (22,4 %) ni le poste carburant (29,7 %), mais l’entretien et la réparation (30,2 %). Pour les ménages, elle a atteint un
total de plus de 160 000 millions d’euros en 2022. Pas de surprise donc, les entreprises dont l’activité consiste uniquement à la réparation automobile représentent 42 % du total des entreprises du
secteur automobile. Cette part ne comprend pas celles qui ont également une activité de commerce.
Résultat : la branche connaît une augmentation régulière du nombre de salariés, de 411 795 en 2014 à 467 558 en 2022. Dans une dynamique positive, depuis dix ans, l’emploi est en constante progression
(+13.5 % depuis 2015), mais la taille des structures reste limitée voire embryonnaire. Plus de la moitié des entreprises ne comptent aucun salarié et seules 5 % des entreprises emploient plus de 10 salariés.
Avec plus de 9 salariés sur 10 en CDI, l’emploi est considéré comme pérenne même s’il faut distinguer des évolutions marquantes par secteurs. Il est stable dans le commerce alors qu’il est en forte progression
dans les activités de maintenance et réparation.
Analysant la bonne santé du secteur, Philippe Le Gall, responsable projets à l’Observatoire des métiers des services de l’automobile déclarait en 2024 : « L’emploi dans la branche du service à l’automobile se porte bien et permet la bonne santé de l’appareil de formation. L’alternance ainsi que les certifications professionnelles sont en augmentation depuis plusieurs années dans les métiers des services de l’automobile. Nous constatons également que les taux d’insertion professionnelle sont très élevés, signe que les entreprises du secteur sont en recherche de nouveaux talents et que l’activité est en progression. »
En effet, les effectifs en formation ont connu une hausse significative avec plus de 71 000 jeunes en formation, principalement en alternance (+6.2 % en 2023). Ce mode de formation a profité depuis 2020 du dispositif « 1 jeune, 1 solution » qui autorise une exonération des cotisations sociales et CSG, à hauteur de 79 % du SMIC et qui octroie une aide « exceptionnelle » de 6 000 à 8 000€.
Un secteur en mutation
Malgré une tendance lourde qui a vu depuis plusieurs décennies de nombreux sites industriels de constructeurs et d’équipementiers fermer sur le sol français, le dynamisme du secteur des métiers de l’automobile, au sens général, ne se dément pas et sa constante évolution est liée à plusieurs facteurs.
L’Association nationale pour la formation automobile (ANFA) en évoque trois :
Réglementaires. Distribution, sécurité, environnement… La réglementation de l’industrie automobile se joue essentiellement au niveau européen. C’est le cas, par exemple, avec les normes antipollution ou la généralisation d’équipements de sécurité.
Technologiques. Communicante et autonome, la vision de l’automobile impose de profondes mutations technologiques, y compris à court terme. Celles-ci ne concernent pas uniquement les domaines traditionnels liés à la mécanique ou l’entretien des véhicules mais aussi ceux de pointe, tels que l’électronique et l’informatique.
Sociaux et sociétaux. La prise de conscience sur les enjeux environnementaux a favorisé l’émergence d’une nouvelle manière d’appréhender l’usage de la voiture. Les professionnels du secteur s’adaptent et la branche elle-même a vu certaines de ses activités se transformer ou en a vu naître d’autres, liées notamment à une nouvelle offre de mobilité.
Le défi de la voiture électrique
Ainsi, la Fédération nationale de l’automobile (FNA) cite en exemple emblématique de cette mutation, la voiture électrique. « Un véhicule électrique nécessite, pour être produit, trois fois moins d’heures de travail qu’un véhicule traditionnel. Fortement touché par les pertes d’emplois (100 000 emplois menacés d’ici 2035) mais créant inversement nombre de postes nécessitant de nouvelles compétences, le secteur automobile va pouvoir en revanche compter sur une production massive de véhicules propres. D’ici 2025, un million de véhicules électriques et hybrides devraient être fabriqués par an en France. Les deux principaux constructeurs français accélèrent leur marche vers l’électrique. La part des véhicules électriques parmi les ventes devrait être à court terme aux alentours de 30 % chez les principaux constructeurs français. »
L’Europe a fixé, pour les constructeurs, l’arrêt de la voiture thermique à 2035. Mais cette décision fait débat car avec l’arrêt des aides à l’achat dans plusieurs pays – et les questions sur la performance, la fiabilité, la réparation ou le recyclage des batteries – les ventes marquent le pas. Et sur le terrain, le constat des professionnels est clair, les garagistes n’ont jamais été autant sollicités par les automobilistes qui préfèrent faire réparer leur véhicule que d’envisager l’achat d’un nouveau véhicule.
Le dynamisme de la branche des services de l’automobile, et les nouvelles compétences qu’ils nécessitent, ne doivent toutefois pas faire perdre de vue aux chefs d’entreprise, y compris dans les plus petites des structures, qu’au-delà de leurs activités professionnelles, ils ont en tant qu’employeur des obligations envers leurs salariés et notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
Stéphane Chabrier