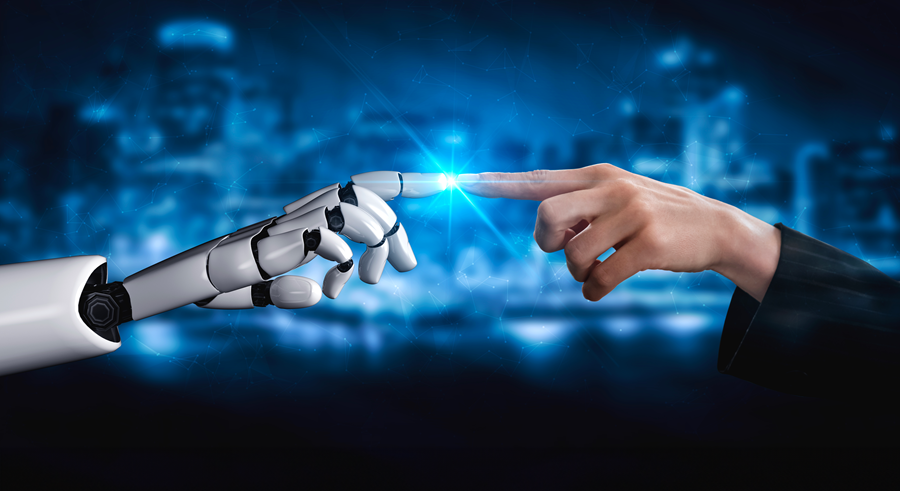Directeur de l’Expertise Corporate & Work Experience à l’Ifop et contributeur régulier de la Fondation Jean Jaurès, Romain Bendavid scrute depuis plusieurs années l’évolution du rapport au travail des Français. À rebours des idées reçues, il estime que les Français restent très impliqués dans leur travail mais souligne qu’ils y expriment aussi de nouvelles aspirations à prendre en compte pour éviter que le divorce si souvent annoncé ne se produise pour de bon.
.
Grande démission, “démission silencieuse”, opposition à la réforme des retraites… L’actualité de ces derniers mois pose la question du rapport au travail des Français. Comment caractériseriez-vous son évolution ?
Il faut aborder ce sujet avec une grande prudence car le rapport au travail reste une affaire personnelle et même intime avec tout ce que cela implique de contradictions internes et d’ambivalences des sentiments.
Cette dimension personnelle est probablement plus importante qu’autrefois car, depuis une vingtaine d’années, les nouveaux modes de management et la littérature dite de développement personnel ont invité chacun à considérer que les tensions inhérentes au travail représentaient des enjeux plus individuels que collectifs ayant pour horizon la réalisation de soi plutôt que le « grand
soir ». Il y a donc autant de rapports au travail que d’individus. Ceci étant dit, une ligne de force se dégage toutefois : le recul continu de la place centrale que les Français accordaient au travail dans leur vie. La proportion de Français en activité affirmant que la place du travail dans leur vie est « très importante » s’est effondrée en un peu plus de 30 ans, passant de 60 % en 1990 à 24 % en 2021
et à 21 % en 2022. Ajoutons que, contrairement à une idée reçue, cet effondrement n’est pas dû à un effet générationnel. Si seuls 21 % des 18-24 ans accordent une place « très importante au travail », c’est aussi le cas de 23 % des 50-65 ans. Nous sommes donc face à un changement global de perception du travail qu’il ne faut toutefois pas caricaturer et surévaluer car, dans le même temps, la proportion de Français qui considèrent que leur travail est important reste assez stable, passant de 92 % en 1990 à 84 % en 2022.
À rebours de ce que l’on entend parfois, il n’y a donc pas, selon vous, de « divorce des Français avec le travail » ?
Il n’y a pas de divorce mais une profonde réévaluation de la place qui lui est accordée comparativement à d’autres aspects de leur vie. Nous assistons plutôt à un rééquilibrage des priorités de chacun dont témoignent bien le renversement des aspirations et des symboles de réussite professionnelle hérités
des Trente Glorieuses et ayant prospéré dans les années 1990. Ainsi, le temps consacré au travail n’est plus valorisé comme autrefois. « L’homme pressé » évoqué par le groupe de rock Noir Désir en 1996 apparaît aujourd’hui has been. Plus généralement, le slogan « travailler plus pour gagner plus », popularisé par Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle de 2007, fait moins recette. Signe des temps, même certains salariés de la banque d’investissement Goldman Sachs – pourtant archétype de l’entreprise capitaliste – ont demandé en 2021 à réduire leurs horaires de travail pour pouvoir passer de 98 heures par semaine à 80 heures, tant le fait de ne pas compter ses heures avait été porté dans cette entreprise à un paroxysme jugé désormais insoutenable. Il y a un renversement des préférences des salariés entre le temps libre et l’argent sur à peine plus d’une décennie. Alors qu’en 2008, une large majorité d’entre eux (62 %) affirmait préférer gagner plus d’argent au détriment du temps libre, ces proportions sont rigoureusement inverses aujourd’hui : 61 % des salariés Français préfèrent désormais gagner moins d’argent mais avoir plus de temps libre (1).
Ce nouvel arbitrage entre revenus et temps de travail concerne-t-il toutes les catégories professionnelles ? Est-il également perceptible dans les classes populaires plus préoccupées par « la fin du mois », notamment en période d’inflation ?
Cette évolution est effectivement plus marquée dans les catégories socioprofessionnelles supérieures où la proportion de salariés privilégiant le temps libre atteint 72 %. Chacun effectue ses propres arbitrages en prenant en compte ses propres contraintes. Or cet arbitrage n’est évidemment pas le même pour les salariés qui redoutent la fin du mois… Cette disparité vaut d’ailleurs aussi pour cet autre symbole déchu de réussite sociale qu’est l’espace de travail. Ainsi, dans les grandes entreprises, le rêve américain d’atteindre un jour le « corner office » – c’est-à-dire le bureau vitré du patron dans le coin de l’étage et avec la meilleure vue – longtemps signe ultime de réussite sociale en entreprise ne semble plus constituer un marqueur statutaire de premier plan. Illustration de ce phénomène, une majorité de salariés (56 %) considère qu’un supérieur hiérarchique continue à être considéré comme tel même s’il n’a pas de bureau individuel. En parallèle, la demande croissante de télétravail paraît se substituer à cette sacralisation du bureau. De la recherche de l’espace le plus en vue du lieu de travail, les employés de bureau aspirent en effet à présent davantage à travailler d’où ils le souhaitent et surtout depuis chez eux, presque à l’abri des regards. Mais en la matière, les contraintes sont encore plus implacables puisque, bien sûr, de nombreux métiers ne sont pas « télétravaillables ». Le télétravail est aujourd’hui pratiqué par 34 % des salariés mais par 71 % des cadres. Cela n’enlève rien au fait que la possibilité de maîtriser son temps et son lieu de travail est une aspiration partagée qui se transforme donc en frustration plus ou moins vive pour ceux qui n’en ont pas la possibilité.
Pour expliquer ce bouleversement, il est fréquent de pointer le rôle de la crise sanitaire. Mais, de votre côté, vous évoquez des évolutions beaucoup plus anciennes, se déployant sur plusieurs décennies…
Le nouveau rapport des Français au travail n’est pas né de la crise sanitaire mais celle-ci a, sans aucun doute, joué un rôle de catalyseur et d’accélérateur. On le voit bien évidemment à travers l’essor sans précédent du télétravail qui a permis de matérialiser une aspiration déjà ancienne. Enfin, cette crise a été l’occasion d’un immense travail d’introspection. C’est bien sûr vrai pour les travailleurs qui ont été contraints à l’inactivité temporaire mais aussi pour beaucoup d’autres. Dans ce moment très particulier chacun s’est interrogé sur le sens de sa vie et aussi de son travail. Et comme les routines avaient été cassées, de nouvelles façons de vivre et de travailler ont été expérimentées ou simplement imaginées, conséquence de cette période d’introspection qui a notamment abouti à élargir le champ des possibles. Le changement est soudain apparu possible. Cela dit, cette libération des imaginaires s’est bien sûr appuyée sur des tendances bien établies comme la montée d’un certain individualisme dans la société. Les comportements sociétaux plus individualistes, tournés vers la recherche de satisfaction et de bénéfices à court terme engendrent en contrepartie moins d’attachement à des structures comme le travail qui requièrent un effort d’adaptation à un collectif. Sur la même période qui a vu le déclin de la place accordée au travail, la proportion de Français qui affirment que les loisirs occupent une place « très importante » dans leur vie est passée de 31 % en 1990 à 39 % en 2022.
De façon plus radicale, vous expliquez aussi que le la place moins centrale du travail pourrait être l’expression d’une forme d’abstention comparable à ce que l’on observe lors des scrutins électoraux, notamment chez les actifs (par rapport aux retraités). Le désengagement proviendrait donc, comme dans la sphère politique, d’une forme de désillusion ?
Il est incontestable que le fonctionnement de notre société est affecté par une perte de confiance dans ses rôles modèles voire par un essor d’une défiance à laquelle le travail n’échappe pas. En l’espace de 30 ans, la proportion des actifs s’estimant perdants dans leur rapport au travail a en effet doublé et atteint désormais près de la moitié de la population. Et cette perception négative n’épargne aucune classe d’âge ni catégorie professionnelle. En 1993, seuls 25 % des actifs français estimaient que dans leur travail, ils recevaient moins que ce qu’ils donnaient. Trois décennies plus tard, en 2022, ils étaient 48 % à le penser ! L’éloignement des centres de décision engendrés par la globalisation a contribué à fragiliser le contrat social qui prévalait lors des Trente Glorieuses. Les plus jeunes générations ont grandi entre vagues de désindustrialisation et crises financières, sans période de croissance économique durable. Beaucoup ont vu leur entourage proche subir de plein fouet chômage et licenciements économiques. Un grand nombre de trajectoires professionnelles ont ainsi été jalonnées d’alternance entre crainte de ne pas trouver d’emploi et crainte de le perdre. Il en a résulté un rapport à l’emploi qui s’est le plus souvent façonné dans un climat anxiogène et contribuant à désacraliser un idéal de réussite et de méritocratie par le travail. Toutefois, c’est davantage l’emploi sous sa forme actuelle qui séduit moins que le travail en tant que tel. L’abstention électorale en hausse et le faible taux de syndicalisation par rapport à des pays comme l’Allemagne ou la Suède n’entraînent pas pour autant de rejet de l’engagement comme le montre la multiplication de diverses formes de mobilisation alternatives comme, par exemple, le mouvement des Gilets Jaunes ou, chez les plus jeunes, les marches pour le climat.

Dans cette tempête, il semble que les entreprises ne sortent pas indemnes. Comment sont-elles aujourd’hui perçues ?
Hélas, la défiance envers l’emploi va de pair avec un attachement et une identification moins affirmée à son employeur. Alors qu’en 2005, 38 % des interviewés déclaraient être « tout à fait » fiers d’appartenir à leur entreprise, ils sont presque moitié moins nombreux (20 %) à partager ce constat en 2022. Toutefois, dans le même temps, les actifs considèrent que c’est davantage en tant que salarié plutôt que comme citoyen qu’ils pourront faire « bouger les choses » dans différents domaines comme le fait de produire davantage en France en relocalisant certaines industries, l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore la mise en place d’actions visant à favoriser la diversité et l’inclusion. Tout se passe comme si le déficit de confiance envers les instances traditionnelles de représentation démocratique suscitait en contrepartie une aspiration à plus de démocratie en entreprise, c’est-à-dire dans un environnement proche et identifiable. Le terme d’« entreprise providence » est ainsi de plus en plus employé pour valoriser la contribution des employeurs à différents enjeux sociétaux alors même que celui d’État-providence est parfois connoté négativement.
Comment expliquez-vous cette prise de distance à l’égard de l’entreprise ?
Une multitude de facteurs peuvent l’expliquer. Un résultat me semble toutefois particulièrement significatif : les salariés français estiment, à tort ou à raison, que leur entreprise leur porte moins d’attention qu’à ses clients. En effet, si 77 % estiment que leur entreprise prend bien en compte les besoins et attentes de ses clients, seule une courte majorité (51 %) considère qu’il en va de même pour ses salariés. Les entreprises ont eu, elles-mêmes, tendance à se désinstitutionnaliser, pour faire face à un marché devenu lui-même plus instable et incertain. Elles ont externalisé, valorisé la « mobilité », la « fluidité », privilégié les contrats courts, recouru plus fréquemment à la sous-traitance, etc. Le moindre attachement des salariés à leur entreprise ne résulte donc pas d’un changement spontané de mentalité. Il s’inscrit dans un mouvement plus vaste de déliaison dans lequel toutes les parties ont pris leur part.
Dans vos travaux, vous soulignez par ailleurs que ce détachement des salariés ne va pas nécessairement de pair avec une moindre implication. Vous semblez ainsi ne pas accorder un grand crédit à la notion de « quiet quitting », cette « démission silencieuse » redoutée de tous les employeurs… Pouvez-vous nous expliquer vos réserves ?
Le « quiet quitting » a fait couler beaucoup d’encre avec plus de 1 500 articles publiés sur ce sujet en France depuis septembre 2022 et contribué à installer le cliché de travailleurs français désimpliqués voire paresseux. Or les enquêtes d’opinion réalisées par l’Ifop montrent que ce phénomène est beaucoup plus limité qu’on ne l’imagine. Ainsi, selon une enquête réalisée en février 2022, pour le groupe de conseil et de courtage en assurances Diot Siaci, plus de 3 salariés sur 4 (77 %) estiment faire en général plus que ce qui est attendu d’eux dans leur poste actuel contre 21 % ce qui est attendu d’eux, sans surinvestissement, et à peine 2 % ce qui est attendu ou parfois moins. La « démission silencieuse » de travailleurs décidant de s’en tenir au strict minimum de leur fiche de poste, sans faire plus que l’attendu ne concernerait donc finalement qu’un salarié sur cinq (21 %). Toujours selon la même enquête, 68 % des salariés affirment s’investir autant dans leur travail qu’avant la crise sanitaire tandis que 10 % affirment s’investir plus et 22 % s’investir moins. De surcroît, l’attachement des Français à leur métier reste massif, les salariés estimant que si leur métier venait à disparaître, il en résulterait une perte importante pour leur entreprise (82 %), pour eux-mêmes (78 %) et pour la société dans son ensemble (72 %). Dans leur grande majorité, les Français sont loin d’avoir le sentiment d’occuper ce que l’anthropologue américain David Graeber a appelé des bullshit jobs, ces « jobs à la con » dépourvus de sens. Ils ont au contraire le sentiment de faire oeuvre utile en travaillant et cela soutient bien entendu leur implication professionnelle.

Toutefois, vous identifiez une inquiétante baisse de motivation qui pourrait quand même finir, si elle se poursuit, par voir des effets néfastes sur l’implication… Comment l’expliquer et surtout y remédier ?
Il est vrai que le sentiment d’implication se mêle, chez beaucoup de salariés, à une inquiétante baisse de motivation. Fin 2022, si une majorité d’entre eux estime que leur motivation demeure stable (58 %), plus
d’un tiers considère qu’elle diminue (36 %) alors qu’à peine 6 % déclarent qu’elle augmente. Il faut d’abord souligner que cette dégradation de la motivation est particulièrement visible lorsque le quotidien des salariés se caractérise par une forme de pénibilité. Les personnes qui mettent plus d’une heure pour se rendre sur leur lieu de travail et celles qui déclarent exercer un métier pénible physiquement, sont les
plus nombreuses à déclarer une baisse de motivation : 43% dans les deux cas contre 36 % en moyenne. Pour maintenir la motivation et l’implication de leurs salariés, les entreprises doivent donc prêter une grande attention à la façon d’améliorer leurs conditions de travail en atténuant autant que possible les facteurs de pénibilité aussi bien physiques que psychologiques. Les enquêtes de climat interne tendent à montrer que la dégradation de la motivation provient souvent aussi d’une frustration quant à la reconnaissance perçue de son travail au quotidien et d’une difficulté de se projeter à long terme chez son employeur. Le sentiment de manquer de reconnaissance est hélas assez massif dans notre pays. Parmi les 77 % de salariés français estimant « en faire plus que ce qui est attendu », une majorité (42 %) considère que leurs managers ne le remarquent pas, quand seulement 35 % pensent le contraire. Pour conjurer le désengagement des salariés, la première chose à faire est certainement de reconnaître leur engagement !
Vous évoquiez aussi, comme motif de démotivation, la difficulté de se projeter à long terme dans l’entreprise…
En 2021, une minorité de salariés français (49 %) affirmait avoir des possibilités d’évolution professionnelle au sein de leur entreprise alors que cette proportion est largement majoritaire en Allemagne (65 %), au Royaume-Uni (68 %) et aux États-Unis (72 %). Or la mobilité interne constitue pourtant un atout de fidélisation indéniable. Elle ne se limite pas forcément à une évolution hiérarchique
qui bute souvent sur un principe de réalité caractérisé par le rétrécissement de la pyramide des postes quand on progresse dans les échelons ou encore par la taille de l’entreprise. En effet, il est évidemment impossible à une PME de promettre à ses salariés une promotion hiérarchique continue tout au long de leur carrière. En revanche, d’autres formes projection professionnelle peuvent être mises en œuvre comme la formation à de nouveaux métiers ou compétences compatibles avec l’activité de l’entreprise, la prise en charge de l’intégration des jeunes par les séniors, le fait d’être acteur d’une politique RSE (plus dans les grandes entreprises), etc. Ce sont là autant de signes tangibles que l’entreprise prend au sérieux ses salariés, qu’elle croit en eux et en leurs capacités et qu’elle compte sur eux. Ces exemples montrent en
tout cas que le désengagement des salariés n’est nullement une fatalité et qu’il reste aux entreprises pas mal de leviers permettant de répondre aux nouvelles aspirations de leurs salariés.
Propos recueillis
par Christophe Blanc
(1) Enquête Ifop pour Solutions Solidaires, réalisée du 20 au 21 septembre 2022 auprès d’un échantillon représentatif de 1011 Français âgés de 18 ans et plus.