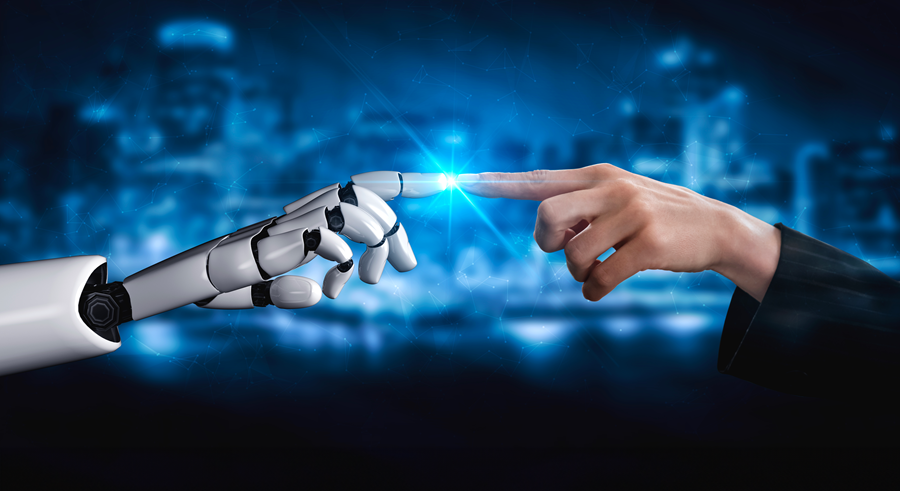Les robots collaboratifs ou « cobots », conçus pour travailler avec les humains en milieu industriel, se démocratisent. De plus en plus d’entreprises en acquièrent pour seconder leurs salariés dans des tâches répétitives. Cependant, cette cohabitation n’est pas sans risque, d’autant que la réglementation paraît loin d’avoir tout prévu.
.
Améliorer de 10 % la productivité d’une activité de pliage ou encore accroître de 40 % la cadence de ponçage. Telles sont, par exemple, quelques unes des performances dont est capable un « cobot » conçu par un des principaux fabricants présents sur le marché en plein essor des robots collaboratifs.
Le cobot appartient à la famille des robots industriels mais il se distingue de ses aînés, tels que les robots de soudure ou de peinture présents dans l’industrie automobile . Ces derniers s’activent dans un espace sécurisé où nul opérateur ne pénètre durant la phase de production. Les cobots, quant à eux, ont été conçus dans le but de collaborer avec des opérateurs. Ils se présentent sous la forme d’un bras articulé, multidimensionnel, auquel on raccorde des accessoires adaptés aux métiers. Les modèles les plus simples se négocient à moins de 10 000 € contre plusieurs dizaines de milliers d’euros pour les plus sophistiqués (finesse des capteurs) avec leurs accessoires (tels qu’une ponceuse, une pince…). Ces tarifs ne les destinent pas au grand public mais ils sont à la portée de PME-PMI en quête d’un moyen d’optimiser leur production. Cependant, un cobot ne s’installe sans précaution ni acculturation des opérateurs.
La réglementation à la traîne
« La sécurité représente un défi pour la mise en œuvre de la cobotique, entre autres, en raison du manque de compréhension des normes de sécurité et des difficultés associées à l’appréciation des risques », alerte un rapport de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) (1). Cet organisme, équivalent de l’INRS en France, fait autorité au Québec. Il est le premier à s’intéresser à la cobotique, du moins au rôle des intégrateurs c’est-à-dire de ceux qui programment ces robots afin qu’ils travaillent efficacement mais sans mettre en danger les opérateurs présents dans leur environnement.
Loin des mythes de la science-fiction, le cobot n’est jamais intrinsèquement brutal ni maladroit : il exécute simplement les tâches qu’on lui confie en fonction de ses capacités et des paramètres qui lui ont été transmis. Cependant la réglementation auxquelles les entreprises pourraient se référer fait défaut. En France, la directive machines de 2006 est muette sur le sujet. Un nouveau règlement européen, élaboré en 2023 pour lui succéder, mentionne les cobots mais il ne s’appliquera qu’en 2027. Quant aux normes internationales, elles ne répondent pas à toutes les interrogations, qu’il s’agisse de l’ISO 12100, de 2010, qui traite de la conception des machines (le cobot n’étant pas une machine) ou des ISO 2018-1 et 2 qui concernent les robots industriels (différents des cobots). Quant à l’ISO TS 15066, venue compléter le tableau en 2016, elle se consacre aux « robots et dispositifs robotiques » mais avec quelques angles morts de la sécurité propres aux cobots. « Un cobot peut être jugé sécuritaire par le constructeur mais ne pas l’être dans son application », met en garde Sabrina Jocelyn, chercheuse spécialiste des machines industrielles et coordinatrice du rapport de l’IRSST. Un écart qui peut s’expliquer par le statut du robot qui n’est pas celui d’une machine mais d’une « quasi-machine ». « Une machine a une fonction bien précise à la différence d’un robot où c’est l’utilisateur qui détermine sa fonction », précise la chercheuse et professeure en robotique collaborative et mobile.
Des progrès mais aussi des risques
Le premier enjeu de sécurité consiste à éviter les collisions, du moins à en limiter les impacts. La dernière réglementation, ISO TS 15066, impose aux fabricants d’éviter toute possibilité de choc avec la tête d’un opérateur. Sur d’autres parties du corps, le cobot ne doit pas provoquer de blessures ouvertes et des seuils d’effort ont été imposés pour trois parties du corps :
- les mains et les doigts,
- les cuisses et les genoux,
- le bas des jambes.
Ainsi, la pression d’un cobot sur une main ne doit pas dépasser 260 N/cm² mais cette force peut doubler lors d’un contact fugace. Pas un mot, en revanche, sur la répétition de tels contacts or le risque de blessure s’accroît si un opérateur se trouve exposé à des collisions en chaîne avec un cobot (par exemple s’il n’arrive pas à se dégager). Par conséquent, l’intégrateur d’un cobot joue un rôle clé pour définir son fonctionnement optimal. « Pour éviter des dommages inacceptables, on pourra proposer des seuils d’effort maximal et des vitesses basses de fonctionnement mais cela risque de poser un problème pour la production », soulève Sabrina Jocelyn. La force et la rapidité du cobot étant deux des principales conditions de son efficacité au travail. « Il y a un compromis à trouver entre la sécurité, la productivité et la santé et il faut procéder par itérations », conseille la spécialiste qui participe au comité ISO pour l’élaboration de normes en robotique industrielle, dont les cobots.
Des tensions musculaires voire psychologiques
La collision n’est pas le seul danger en travaillant avec un robot collaboratif. « Il peut y avoir des postures contraignantes à l’origine de troubles musculosquelettiques », évoque la scientifique. Quand un cobot manipule un objet puis le tend à un opérateur, il n’est pas certain que celui-ci sera dans la meilleure position pour le recevoir. S’il doit, par exemple, se mettre en extension ou tendre ses bras, il risque des douleurs au dos, à force de répéter le même geste. Là encore, l’intégration robotique est décisive pour que les mouvements du cobot s’adaptent à l’opérateur et non l’inverse. Enfin, travailler avec un cobot peut devenir une source de tension psychologique pour l’opérateur qui doit s’adapter à ce nouveau “compagnon de travail” et ne jamais se trouver en défaut, au risque de pénaliser la production ou de se blesser. « Il y a plus de stress cognitif et de l’anxiété liée à la vitesse du cobot », analyse Sabrina Jocelyn.
Autrement dit, un cobot ne s’installe pas tel quel, une fois déballé du carton. « Il implique l’employeur et les employés dans un processus d’intégration », martèle la chercheuse. Elle a d’ailleurs identifié plusieurs étapes essentielles sur lesquelles s’interroger : le choix du cobot, le type de pièce à manipuler et les outils, les contraintes du cycle de production et de productivité, la formation des intégrateurs en sécurité cobotique (sécurité des machines mais aussi ergonomie), l’information donnée aux salariés (influence du collectif de travail pour orienter chacun vers un priorité donnée à la sécurité ou à la productivité). Avant de décrire les tâches impliquant un cobot, l’analyse des risques nécessite de s’interroger sur le besoin de l’entreprise de recourir à un cobot. Par exemple, pour la manipulation de charges lourdes, « parfois, un exosquelette fait l’affaire », pointe Sabrina Jocelyn. Quoi qu’il en soit, rien ne doit être imposé aux opérateurs. Au contraire, l’intégration réussie d’un cobot dans un environnement de travail passe par un dialogue approfondi avec toutes les parties prenantes.
Jean-Philippe Arrouet
(1) “Identification en laboratoire des éléments essentiels au processus d’intégration sécuritaire de cellules cobotiques”, sous la direction de Sabrina Jocelyn, 2024, consultable sur www.irsst.qc.ca