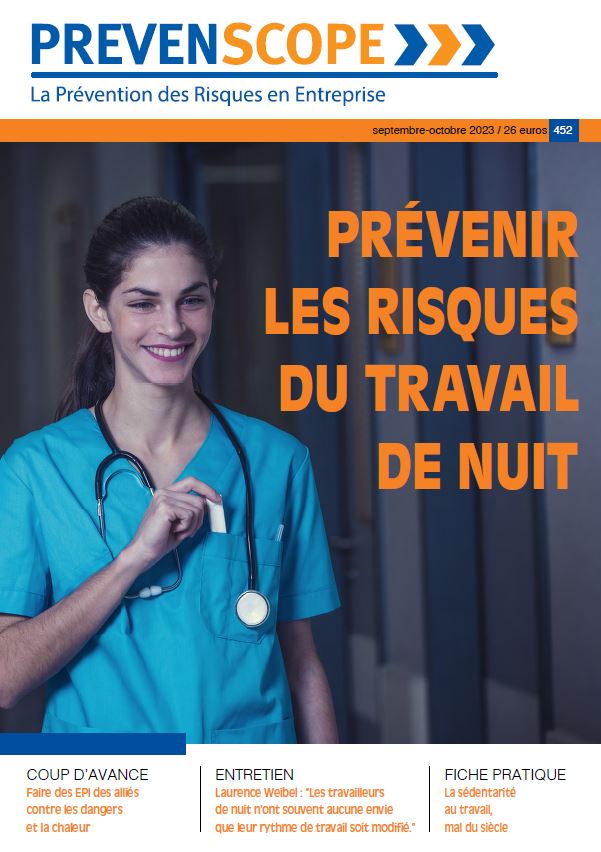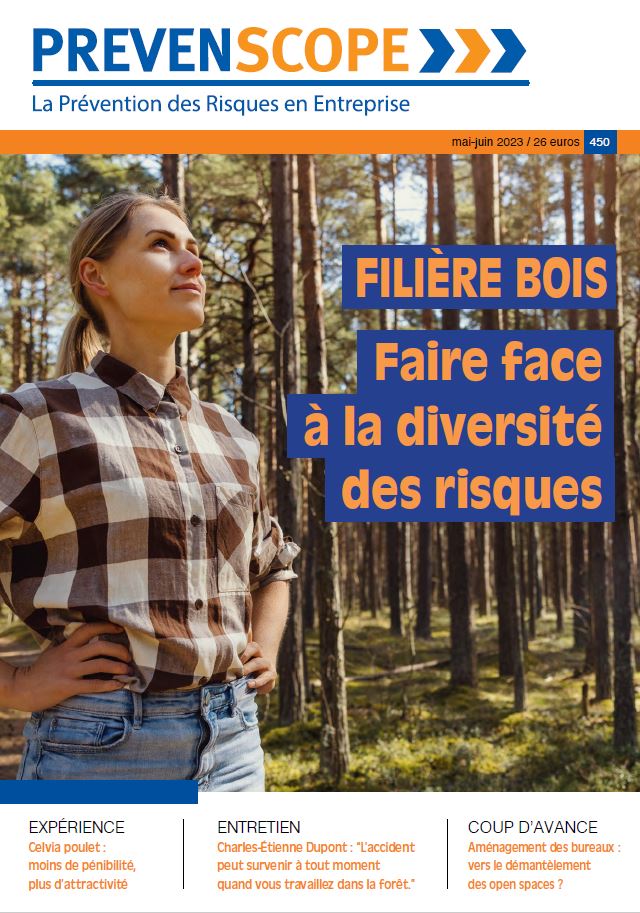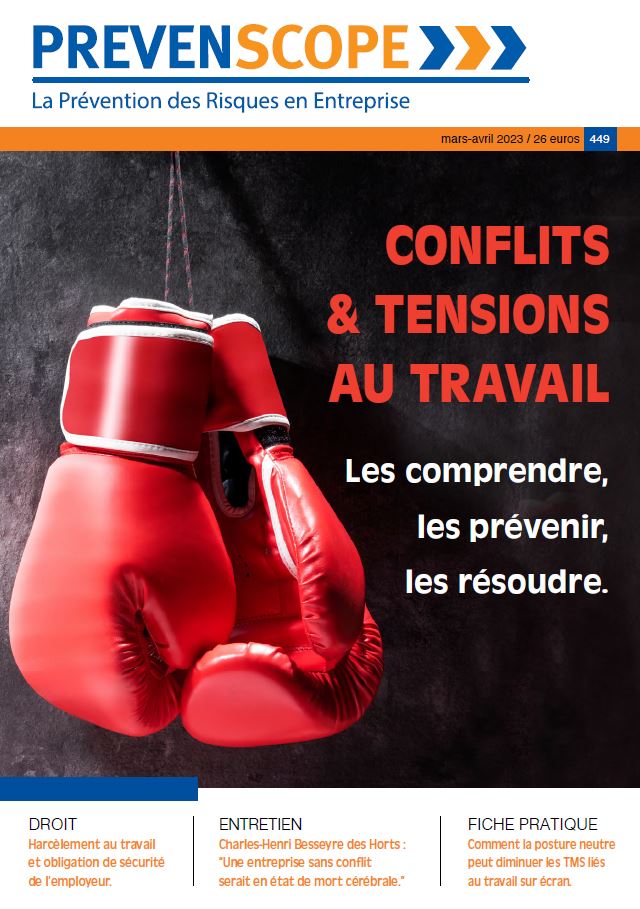La nécessaire attention portée à la conception des lieux et des postes de travail de façon à ce qu’ils préservent la santé et la sécurité des travailleurs découle directement des principe généraux de la prévention énoncés à l’article L4121-2 du Code du travail. Sur les neuf principes listés, cinq ont une grande portée pratique s’agissant des lieux de travail. En voici une synthèse, s’appuyant notamment sur les réflexions d’Hervé Lanaouzière, directeur de l’Institut national du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et Emmanuelle Wurtz, avocate générale à la chambre sociale de la Cour de cassation, dans leur ouvrage de référence, paru en 2023, La santé au travail (1).
« Éviter les risques » (principe #1)
Ce principe rappelle la primauté de la « prévention primaire » consistant à agir sur les causes profondes des risques. Il renvoie donc directement à la conception des lieux de travail et à l’organisation du travail. Il s’agit par exemple de concevoir un nouvel atelier de telle sorte que le processus de production évite le port de charges lourdes par les travailleurs.
Bien entendu, la prévention primaire donne des résultats optimaux lorsqu’elle est mise en oeuvre dès la phase de conception des locaux et du projet de l’entreprise. Comme l’écrivent Hervé Lanouzière et Emmanuel Wurtz, « éviter les risques implique de se livrer à une démarche de questionnement dont les chances de succès sont d’autant plus élevées qu’elles se situent le plus en amont de la conception d’une organisation, d’un système, d’une installation, d’un équipement, d’un bâtiment professionnel ».
Ce questionnement est tout sauf abstrait et théorique. Il s’agit au contraire de se représenter le travail qui sera accompli en répondant à une série de questions très pratiques :
– Que fait-on à tel poste de travail ?
– Où se situe le travailleur quand il accomplit ses tâches ?
– Comment s’y prend-il concrètement pour le faire ?
– Quelles sont les dangers et les contraintes auxquels il est exposé à ce moment-là ?
– Etc.
En répondant à ces questions, il est ensuite possible d’éviter les risques identifiés en s’interrogeant d’un même mouvement sur la conception du bâtiment, les procédés de productions et les modes d’organisation choisis. Si cette démarche est d’autant plus efficace qu’elle est menée en amont, elle peut être réalisée postérieurement à la conception des lieux de travail, dans une démarche de correction ou d’amélioration, notamment à l’issue de l’évaluation des risques professionnels.
« Combattre les risques à la source » (principe #3)
« Combattre le risque à la source doit être compris comme l’exigence de combattre prioritairement “l’origine” ou “la cause” du risque. Il s’agit de remonter à la source c’est-à-dire d’identifier le phénomène dangereux que l’on entend combattre et de s’attaquer aux causes mêmes du phénomène, si possible en le supprimant », écrivent Hervé Lanouzière et Isabelle Wurtz.
Prenons un exemple : dans un atelier, il est bien sûr possible de fournir des aides mécaniques à la manutention pour soulager les travailleurs astreints à porter des charges lourdes. Mais le choix d’une disposition des lieux réduisant les distances de manutention se révèle une solution beaucoup plus rationnelle et efficace aussi bien en termes de productivité que de santé.
Ici encore, cette démarche est évidemment beaucoup plus aisée à mettre en oeuvre lorsqu’elle est réalisée dès la conception des lieux de travail. Mais il peut également être avantageux de procéder à ce type de réaménagement dans des locaux existants, notamment dans le cadre d’un plan d’action de prévention des risques professionnels.
« Adapter le travail à l’homme » (principe #4)
Le quatrième principe général de la prévention enjoint d’adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. Il fait directement référence aux savoirs ergonomiques mobilisés pour concevoir des postes de travail. « Ce principe signifie que ce n’est pas le travailleur qui doit s’accroupir pour ébavurer une pièce de fonderie au sol, et ce faisant adopter une posture pénible l’exposant à un risque d’accident ou de pathologie dorsolombaire, mais la pièce qui doit être surélevée. Elle peut par exemple être déposée à hauteur d’homme sur un support approprié, au besoin orientable, de manière que le travail puisse être réalisé dans les meilleures conditions de santé et de sécurité ». Et il en est bien sûr de même au bureau, où les écrans et claviers d’ordinateurs doivent être positionnés de façon à éviter les torsions des employés qui les utilisent.
Mais, au-delà de ces attentions à l’ergonomie stricto sensu, l’adaptation du travail à l’homme porte des exigences en matière d’organisation du travail et donc de l’espace de travail, à l’échelle collective. Pour ne prendre qu’un exemple, il est parfaitement documenté que les troubles musculo-squelettiques (TMS) ne résultent pas seulement de postures inadaptées mais aussi – entre autres facteurs – des tâches répétitives et monotones sous cadence. Or, la volonté d’éviter ces risques peut s’inscrire dans la conception même des lieux de travail. Prenons un exemple : les guichets où les clients prennent des tickets et sont appelés par l’opérateur lorsqu’il a terminé de traiter correctement le précédent client permettent une gestion très différente de la cadence des services où les clients font le queue devant le guichet. Mais l’aménagement du service et la conception de la pièce ne sont pas les mêmes. Dans le second cas, les clients patientent dans une pièce aménagée comme une salle d’attente avec vue sur des écrans d’appel.
« Tenir compte de l’évolution de la technique » (principe #5)
Ce principe vient contrebalancer l’idée selon laquelle tout se joue au moment de la conception initiale des lieux de travail et de l’activité. En effet, il est lié à l’obligation générale d’amélioration continue des situations existantes prévue au dernier alinéa de l’article L 4121-1. Celui-ci précise que lorsqu’il prend des « mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », l’employeur doit « veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Que chacun se rassure toutefois : aucun employeur ne sera tenu de réorganiser de fond en comble ses espaces de travail à mesure que de nouvelles techniques ou procédés de fabrication font leur apparition. En effet, comme le soulignent Hervé Lanouzière et Isabelle Wurtz, cette exigence est tempérée par un principe de proportionnalité : « Il ne saurait être question d’imposer le recours à une solution au seul motif qu’elle existe si sa mise en oeuvre demande des moyens exorbitants au regard des possibilités de l’entreprise et du risque encouru. »
Reste que la prise en compte des évolutions techniques et scientifiques est une nécessité maintes fois réaffirmée. Ainsi, dans un arrêt du 15 novembre 2001, la Cour de justice de l’Union européenne rappelait qu’ « il importe de préciser que les risques professionnels devant faire l’objet d’une évaluation professionnelle ne sont pas déterminés une fois pour toutes, mais évoluent constamment en fonction, notamment, du développement progressif des conditions de travail et des recherches scientifiques en matière de risques professionnels ».
« Privilégier les mesures de protection collective » (principe #8)
Lorsqu’il s’agit de concevoir ou de réaménager un lieu de travail, le huitième principe général de prévention, invitant à donner la priorité aux mesures de protection collective sur les protections individuelles, joue un rôle central. Il prend en effet tout son sens en phase de conception, où il est possible d’intégrer des dispositifs de protection efficaces, durables et peu contraignants pour les salariés.
Les protections collectives, parce qu’elles sont intégrées à l’environnement de travail, permettent d’agir à la source du risque. Un système de ventilation adapté, un garde-corps fixé dès la construction, un dispositif de captation des poussières ou une barrière de sécurité sont autant d’exemples qui protègent l’ensemble des travailleurs sans dépendre du comportement individuel de chacun.
Dans une logique de prévention, anticiper ces dispositifs dès la conception des locaux évite d’avoir à ajouter, plus tard, des équipements provisoires ou contraignants. C’est aussi une façon de renforcer l’efficacité des dispositifs de sécurité, en les rendant plus invisibles mais pleinement actifs dans l’organisation de l’espace. Ce type de protection est également plus fiable à long terme : il ne dépend ni du port régulier d’un équipement de protection individuelle (EPI), ni d’une vigilance constante.
En intégrant ces mesures collectives en amont, l’entreprise gagne en clarté d’organisation, en fluidité des déplacements et en sécurité générale. C’est un choix qui allège la charge mentale des salariés et facilite la gestion quotidienne pour les encadrants. Il contribue à créer un environnement de travail plus sain, sûr et serein.
(1) La Santé au travail. Droit et pratique, par Emmanuelle Wurtz et Hervé Lanouzière, Éditions Economica, juin 2023, 592 p.