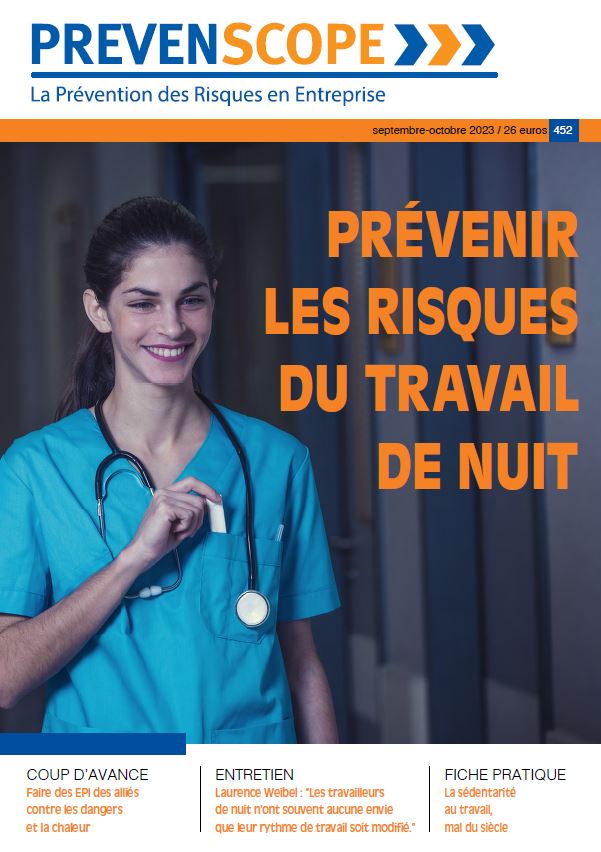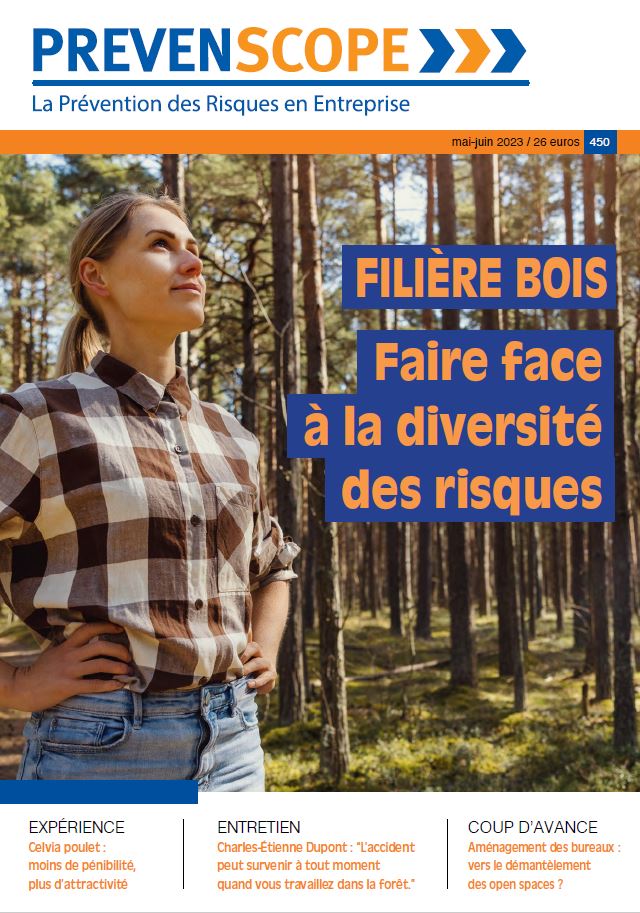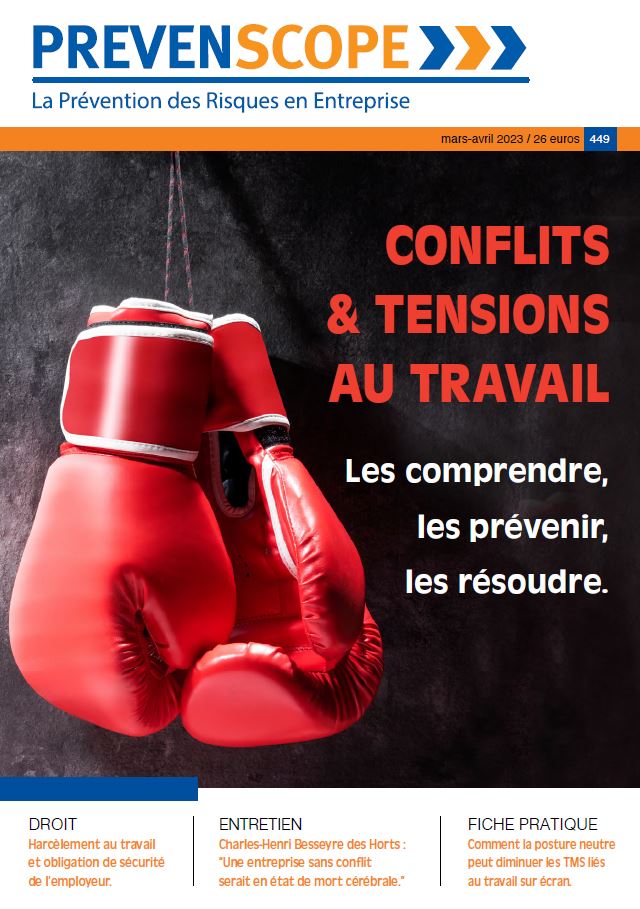Alcool, tabac, cannabis, médicaments psychoactifs… Les conduites addictives concernent tous les milieux professionnels, sans distinction de secteur ou de catégorie socioprofessionnelle. L’INRS rappelle que ces consommations, souvent à l’intersection des fragilités individuelles et des conditions de travail, exposent non seulement les salariés mais aussi l’entreprise tout entière à des risques multiples : santé dégradée, absentéisme accru, accidents du travail, responsabilité juridique de l’employeur. Prévenir ces pratiques ne relève donc pas d’un simple geste de bienveillance : c’est une obligation légale et un investissement rentable pour l’organisation.
Stress chronique, horaires atypiques, travail de nuit ou en week-end, tâches pénibles comme le port de charges lourdes ou le travail au froid, isolement, précarité professionnelle, relations sociales conflictuelles… autant de facteurs professionnels qui favorisent le recours aux substances psychoactives. Dans certains secteurs, l’accessibilité même des produits constitue un facteur aggravant : boissons alcoolisées dans l’hôtellerie-restauration, médicaments psychoactifs dans la santé, solvants ou substances chimiques dans l’industrie.
Ces risques doivent être identifiés et inscrits dans le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). L’objectif est de mettre en œuvre des mesures adaptées qui agissent en amont, sur l’organisation du travail, et non uniquement sur les comportements individuels. Cette approche collective garantit la cohérence de la démarche et protège juridiquement l’entreprise en cas d’accident.
Encadrer pour protéger
La consommation d’alcool au travail illustre particulièrement ce besoin de régulation. Pots, repas d’affaires, séminaires ou congrès sont autant de moments de convivialité qui, mal encadrés, peuvent favoriser des pratiques addictives.
Les recommandations de l’INRS prévoient plusieurs règles simples : limiter la quantité d’alcool, prévoir systématiquement des boissons non alcoolisées, proscrire les alcools forts (seuls cidre, bière, vin et poiré sont autorisés par le Code du travail), définir un horaire permettant la reprise du travail sans risque, mettre à disposition de quoi se restaurer afin de limiter le pic d’alcoolémie.
Surtout, l’incitation à consommer doit évidemment être proscrite. Il s’agit de protéger les publics vulnérables – jeunes, femmes enceintes, salariés en traitement médical – et de respecter ceux qui choisissent de ne pas boire. Pour certains postes à risque (conduite de véhicules, travail en hauteur, manipulation de produits dangereux), la limitation voire l’interdiction de toute consommation doit être intégrée au règlement intérieur.
Une responsabilité juridique et pénale
La loi est claire : l’employeur est tenu de protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du Code du travail). En cas d’accident, l’état d’ébriété d’un salarié n’exonère pas l’entreprise de sa responsabilité. Si la prévention n’a pas été correctement mise en oeuvre, le chef d’entreprise peut être mis en cause tant sur le plan civil que pénal. La cohérence et la dimension collective de la démarche de prévention seront alors scrutées par le juge. Autrement dit, une politique structurée de prévention constitue aussi une protection juridique pour l’employeur.
Informer, sensibiliser et accompagner
La prévention passe aussi par l’information régulière des salariés. Ceux-ci doivent connaître les effets des substances psychoactives sur la vigilance, la mémoire, l’humeur et les capacités physiques. Ils doivent également être formés à réagir face à un collègue en difficulté : interrompre une activité dangereuse, alerter les secours, prévenir le service de santé au travail.
Les dispositifs d’aide doivent être connus de tous : médecin du travail, médecin traitant, centres de soins et de prévention en addictologie, plateformes spécialisées (Alcool info service, Drogues info service, Tabac info service, Addict’AIDE). Des outils pratiques – affiches, guides, supports numériques – sont disponibles gratuitement sur le site de l’INRS.
Un enjeu économique et social
Au-delà de la santé, l’impact économique est majeur. Les conduites addictives entraînent absentéisme, erreurs, baisse de productivité, accidents du travail, dégradation du climat social. À l’inverse, une politique de prévention cohérente réduit le taux d’absentéisme, améliore la productivité et favorise une meilleure image interne et externe de l’entreprise. Elle renforce aussi le sentiment d’attention et de bienveillance de l’organisation vis-à-vis de ses collaborateurs, ce qui contribue à leur fidélisation.
Les bénéfices sont multiples : moins d’accidents, cotisations réduites, meilleure santé des salariés, attractivité accrue de l’entreprise. La prévention des addictions est aussi un acte de bonne gestion qui renforce la performance globale de l’entreprise.
Travail et santé : un équilibre à trouver
Les données épidémiologiques rappellent cependant un point essentiel : l’activité professionnelle reste globalement un facteur protecteur face aux addictions. Les inactifs présentent des taux plus élevés de tabagisme, d’alcoolisation excessive et de consommation régulière de cannabis. Le travail, malgré ses contraintes, contribue donc à structurer les comportements et à réduire les usages problématiques. À condition toutefois que l’entreprise assume pleinement son rôle de prévention et de soutien.
Pierre Sarian
Pour aller plus loin : www.inrs.fr et www.addictaide.fr/pro/
POTS D’ENTREPRISE : DES RÈGLES À RESPECTER Moment attendu de convivialité dans la vie professionnelle, le pot d’entreprise – qu’il s’agisse d’un départ, d’un succès commercial ou d’une fête de fin d’année – n’est pourtant pas un acte anodin sur le plan juridique. Derrière l’image festive, il engage directement la responsabilité de l’employeur, tenu par une obligation de sécurité envers ses salariés.
Un cadre légal strict
Le Code du travail (article R. 4228-20) autorise uniquement la consommation de vin, bière, cidre et poiré sur le lieu de travail. Les spiritueux sont interdits et le non-respect de cette règle expose l’employeur à une amende pouvant atteindre 3 750 € par salarié présent. Depuis 2014, l’entreprise peut aller plus loin en limitant ou interdisant toute consommation d’alcool dans ses locaux, à condition de justifier cette décision et de l’inscrire dans le règlement intérieur ou dans une note de service. La HAS recommande d’ailleurs une interdiction totale des boissons alcoolisées lors des événements professionnels.
La responsabilité de l’employeur ne s’arrête pas aux portes de ses locaux. Un pot organisé dans un restaurant ou un bar engage tout autant sa responsabilité. En cas d’accident survenu pendant ou à la suite de l’événement, celle-ci peut être recherchée, y compris sur le plan pénal. La jurisprudence en témoigne : en 2007, un employeur a été condamné après le décès d’un salarié ivre au volant, faute d’avoir contrôlé sa consommation lors d’un repas d’entreprise. Dans d’autres cas, les collègues eux-mêmes peuvent être poursuivis pour non-assistance à personne en danger.
Prévenir pour protéger
Au-delà de l’interdiction de l’ivresse au travail, le Code du travail impose à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Cela implique de définir un cadre précis aux pots : horaires adaptés aux activités exercées, limitation du nombre de verres, présence obligatoire de boissons sans alcool et de nourriture, mise à disposition d’éthylotests et organisation sécurisée du retour à domicile. L’INRS recommande également de prévoir une procédure en cas d’ivresse manifeste : arrêt immédiat de l’activité et recours à un avis médical si nécessaire.
L’attention doit être renforcée pour les jeunes travailleurs et apprentis, particulièrement exposés. Faire boire un mineur jusqu’à l’ivresse est passible d’une amende de 7 500 €, tandis qu’inciter un mineur à une consommation habituelle d’alcool peut valoir jusqu’à deux ans de prison et 45 000 € d’amende. L’inspection du travail peut aller jusqu’à suspendre un contrat d’apprentissage si la santé ou l’intégrité d’un jeune est compromise.
Convivialité responsable
Les pots d’entreprise ne sont pas condamnés : ils restent des moments forts de cohésion. Mais ils exigent une organisation responsable et un encadrement précis pour éviter que la convivialité ne se transforme en drame. En structurant ces pratiques, les dirigeants protègent à la fois leurs salariés et leur propre responsabilité.
Pour aller plus loin : Brochure “Point juridique : le pot en milieu professionnel”, consultable sur www.addictaide.fr/pro/