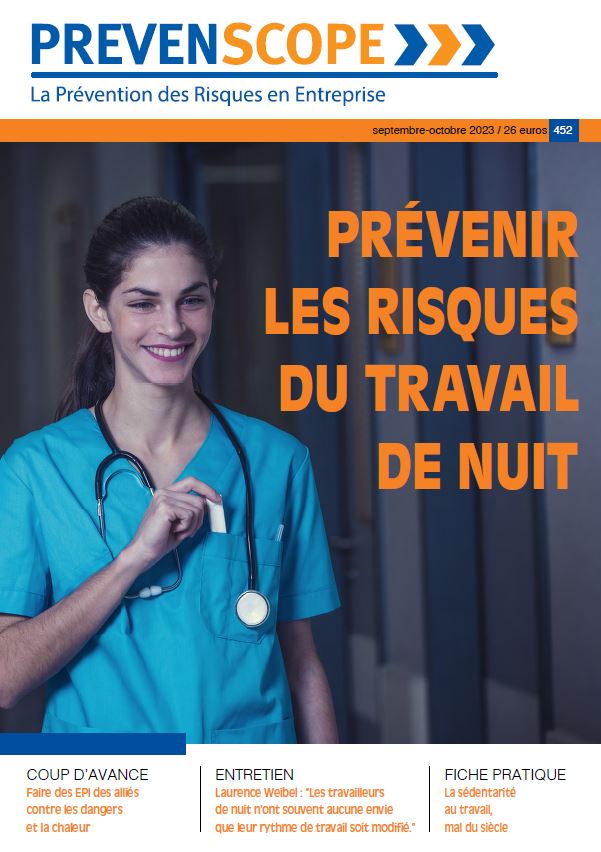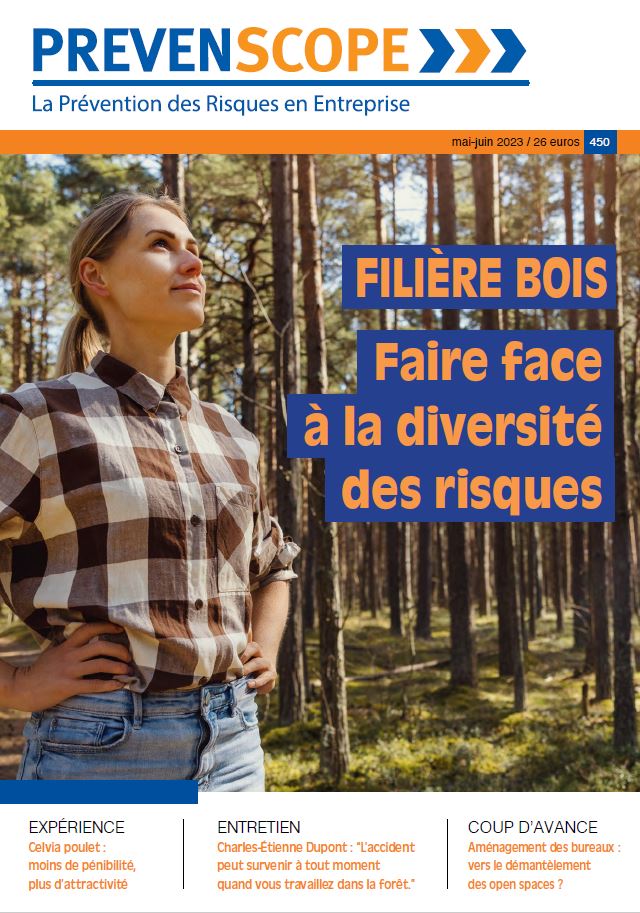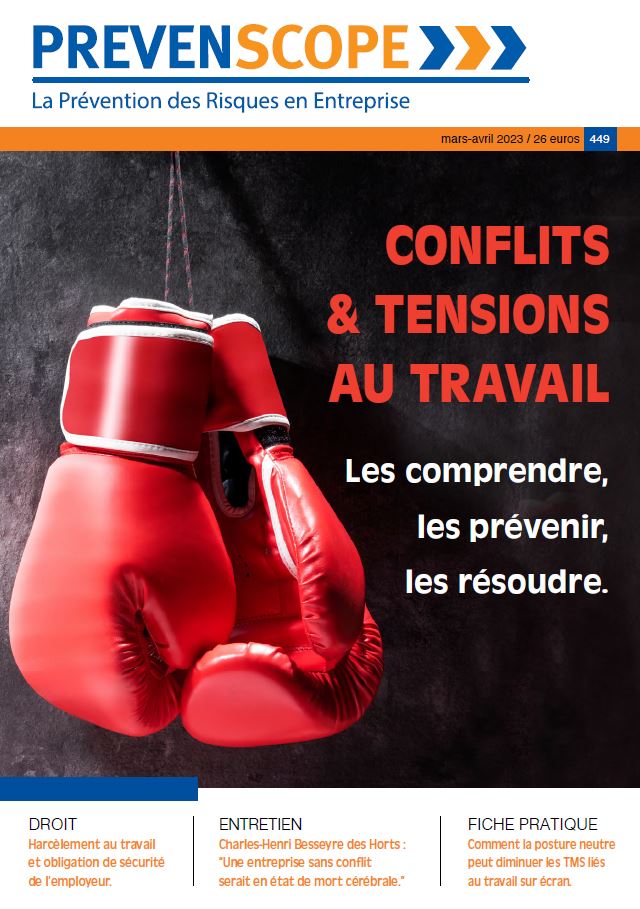L’article L4121-1 du Code du travail fixe la responsabilité de l’employeur en cas d’accident. Mais avant d’en arriver là, il précise avant tout les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail et en particulier qu’il doit fournir au salarié un niveau maximum de sécurité pour le protéger physiquement et mentalement. La branche des métiers de l’automobile ne fait pas exception à la règle. Au contraire, dans son paysage constitué de 140 000 entreprises, dont 95 % de type TPE avec une dizaine de salariés au maximum, la question de la sécurité est un enjeu qui peut s’avérer crucial. Outre un drame humain, un accident grave peut remettre en cause l’existence même d’une entreprise lorsque les mesures préventives ne sont pas respectées.
Pour l’année 2023, la Caisse nationale de l’Assurance maladie (CNAM) signale que les données de la sinistralité s’inscrivent dans la continuité de celles publiées pour l’année précédente, mais les chiffres révèlent aussi des différences notables entre les accidents du travail (AT), en baisse de 1,5 %, tandis que les accidents de trajet et les maladies professionnelles augmentent respectivement de 5.1 % et de 7,3 %. Au total, cela représente pour les entreprises 835 000 journées de travail perdues en 2023.
Parmi les facteurs de risques, les manutentions manuelles (50 %) et les chutes de plain-pied ou de hauteur (30 %) sont les plus fréquents. Ces risques sont particulièrement présents dans les activités professionnelles liées aux services de l’automobile.
Au total, concernant les activités professionnelles de la branche des métiers de l’automobile, une douzaine de risques sont identifiés dans le livret de sécurité publié en 2019 par la Commission paritaire nationale des services de l’automobile composée des organisations professionnelles représentants les entreprises et les salariés. Ces risques sont :
Chutes de plain-pied
Omniprésent, quelles que soient les activités, le risque de chute de plain-pied est particulièrement présent sur les sites de travail de type atelier, où les situations d’accident sont nombreuses : glissade sur une tache d’huile ou un sol mouillé, trébuchement en heurtant un objet posé au sol ou sur le pied d’un pont de levage et autres pertes de contrôle, comme marcher sur un boulon qui traîne au sol… Des situations souvent jugées anodines mais qui peuvent avoir de graves conséquences pour la victime.
Pour prévenir ce risque, un aménagement des locaux afin de dégager les couloirs de circulation et d’accès aux machines ainsi que les câbles et les fils électriques des outils de travail est nécessaire de même que l’évacuation des déchets et le nettoyage régulier des sols. Parmi les EPI, il faut mettre à disposition des salariés circulant sur les sites à risque et autres ateliers, des chaussures de sécurité antidérapantes.
Chutes de hauteur
C’est un risque largement répandu dans toutes les situations de travail : dans un bureau ou sur un site logistique, pour accéder à des rayonnages en hauteur, à la cabine d’un poids lourd ou sur un camion-citerne. L’accès d’une zone en surélévation, depuis une échelle, une passerelle, une mezzanine ou un échafaudage sont autant d’autres situations à risque à ne pas négliger.
La prévention du risque passe par la bonne l’utilisation des moyens d’accès des salariés concernés. L’organisation du stockage peut également permettre de limiter les risques en choisissant, quand c’est possible, de ne placer en hauteur que les matériels les moins souvent utilisés.
Postures contraignantes et manutentions manuelles
Dans un véhicule lourd ou léger, les interventions
autour du moteur et de ses
organes essentiels nécessitent souvent
une « gymnastique » des techniciens qui
n’a rien de naturel. Couché sous le véhicule,
à genoux, penché dans le moteur, les
contraintes posturales sont inévitables et
le travail s’effectue aussi parfois à bout de
bras ou les bras en l’air sous un pont.
Quant à la manutention, elle peut concerner
des matériels lourds du type pneumatique.
Résultat, malgré tous les progrès techniques
et la mise à disposition d’outils adaptés,
les corps sont soumis à rude épreuve et le
risque d’AT est important (concernant des
traumatismes musculaires), comme celui
des maladies professionnelles (MP) et
d’inaptitude au travail : troubles musculosquelettiques
et autres lombalgies.
Il est dès lors nécessaire de réorganiser
les postes de travail pour diminuer ou
supprimer les manutentions et de prévoir
des équipements permettant de réduire
les efforts et soulager les postures contraignantes
(table élévatrice, chèvre, chariot
mobile, vérin hydraulique, etc.).
Manutentions mécaniques inadaptées
Le port et le déplacement de charges
lourdes ou encombrantes sont des opérations
fréquentes dans les services de l’automobile,
notamment lorsqu’il faut sortir un
moteur d’un châssis ou déplacer une roue
de poids lourd.
Ces situations ne sont pas sans danger et
nécessitent l’usage d’engins et de matériels
adaptés, auxquels seuls des salariés formés
et sensibilisés aux risques doivent avoir accès.
La vérification régulière et l’entretien
de ces matériels (chèvres, crics, ponts élévateurs,
etc.) sont bien sûr également indispensables.
Les zones d’intervention doivent
être balisées avec des barrières rigides et
stables et une signalisation doit prévenir
voire interdire aux autres collaborateurs le
passage à proximité des engins de manutention
en activité.
Mauvais usage des outils et des machines
Les ateliers de mécanique fourmillent d’outils
: presses, moyens de levage, clefs à choc,
machines à pneu, équilibreuses… Attention
aux accidents qui peuvent résulter de heurts des parties mobiles des machines, de chutes d’objets ou de véhicules, ou encore de projections de particules solides ou de matière incandescente. Toute sorte de lésions sont alors envisageables, de type écrasements, coupures ou perforations.
Pour limiter les risques, les utilisateurs doivent respecter les consignes d’utilisation de ces outils et machines, vérifier que les dispositifs d’arrêt d’urgence sont en fonction, signaler les anomalies de fonctionnement et ne pas utiliser les machines en cas de doute lié à un dysfonctionnement.
Exposition aux produits et substances chimiques
Sous forme solide, liquide ou gazeuse, les produits chimiques peuvent aussi se présenter sous forme de poudre, poussières, fumées, particules, fibres ou brouillard… D’origine naturelle ou fabriqués de synthèse, ces produits (colles, diluants, dégraissants, peintures, vernis, solvants…) sont manipulés au quotidien sur certains postes de travail, comme ceux liés à la carrosserie.
La sensibilisation et l’information des salariés en contact avec ces produits sont essentielles. Il faut se référer aux étiquettes pour connaître, via le pictogramme, le type de danger auquel s’expose celui qui manipule le produit en question et ses effets possibles sur la santé et l’environnement. Elles précisent aussi les précautions à prendre pour l’utilisation mais aussi le stockage des produits. Enfin, chaque produit s’accompagne d’une fiche de données de sécurité (FDS) qui complète et détaille les informations liées aux différents produits, au-delà des seules indications inscrites sur les étiquettes.
Pour prévenir les risques, l’entreprise doit se doter des équipements de protection, collectifs (cabine de peinture, extracteur de gaz et de fumées d’échappement, ponceuse aspirante…) ou individuels (gants, combinaison de travail, appareil respiratoire adapté…).
Nuisances sonores
Le bruit est inhérent à un travail en atelier, du fait de l’utilisation des machines et du fonctionnement des moteurs à l’essai. Le danger vient aussi des bruits impulsionnels générés par les chocs, les coups, les échappements d’air comprimé, les signaux sonores, etc. À terme, l’exposition excessive de bruit peut entraîner des maladies professionnelles voire une surdité irréversible. Face à ce danger également, l’entreprise doit faire en sorte de se doter des équipements moins bruyants que les précédents lors de leur remplacement et organiser au mieux ses ateliers, de façon par exemple à séparer les activités mécaniques de celles liées à la carrosserie. Il faut aussi s’assurer auprès des équipes du port des EPI mis à disposition (casques, bouchons d’oreilles…).
Risque électrique
Parmi les risques inhérents à toute forme d’activité, y compris professionnelle, le risque électrique peut provoquer des accidents à fort caractère de gravité (électrocution, explosion, incendie), quelle que soit leur origine, de la mauvaise manipulation au risque d’arc électrique. Ce risque s’est amplifié dans les métiers de l’automobile, ces dernières années, avec l’avènement de la voiture voire du camion électrique.
Certes l’intervention sur un véhicule ou une installation électrique nécessite une formation ou une habilitation, mais le simple contact avec des outils et du matériel électrique réclame, de la part des entreprises, des mesures préventives rigoureuses : la vérification des certifications des matériels utilisés et leur état jusqu’au câble d’alimentation. Leur usage doit être conforme aux indications, en évitant de tirer sur le câble pour débrancher l’appareil et en s’assurant du fonctionnement des dispositifs de sécurité. Il va de soi qu’il faut aussi vérifier l’état de la prise de branchement voire privilégier les interventions hors tension dès que la situation de travail le permet.
Explosion et incendie
Le moindre court-circuit dans un atelier ou sur un véhicule ne peut être traité de manière anodine. Un tel incident peut entraîner des conséquences graves, aussi bien pour les salariés que pour les installations, lorsque le problème n’est pas traité correctement par les intervenants éventuels ou que ceux-ci ne disposent pas des moyens adéquats.
Si l’isolement des zones à risque n’est pas toujours possible dans des ateliers de taille réduite, il faut a minima mettre à disposition
des salariés les plans d’évacuation. Une
information de la conduite à tenir en cas de
danger est essentielle ainsi que la formation
du personnel à l’utilisation des extincteurs.
Circulation dans l’entreprise
Sur un site de travail, les croisements entre
les engins de manutention, voire les voitures
dans les garages, et les piétons peut
occasionner des accidents graves en cas de
collision mais aussi lors d’une utilisation
mal contrôlée d’un engin, par exemple.
Dans la mesure du possible, lorsque la taille
des sites (garage, atelier, etc.) le permet, des
zones de circulation séparée doivent être
définies et signalées (peinture au sol, signalisation
verticale, balisage…) et les flux de
circulation organisés de manière à éviter
au mieux leurs croisements. Les fosses de
visite doivent aussi être signalées ou protégées.
Quant aux conducteurs des engins, ils
doivent être soumis à une formation préalable.
Risque routier
Premier facteur de mortalité au travail, le
risque routier est pratiquement indissociable
d’une activité professionnelle. La
plupart des activités nécessitent des déplacements,
réguliers ou occasionnels, d’autant
plus dans les métiers du commerce ou
de la réparation, dans la branche automobile,
où les déplacements et autres essais de
véhicules, légers ou lourds, sont indispensables
à l’activité de l’entreprise. Et lorsqu’il
ne s’agit pas de déplacements liés à des missions,
ils concernent les trajets des salariés
pour se rendre sur leur lieu de travail.
Dans le cadre de l’entreprise, le chargement
d’un véhicule sur plateau doit s’accompagner
d’un contrôle effectif de l’arrimage et
les véhicules de service mis à disposition
des salariés doivent être dotés d’équipements
de sécurité : témoin de surcharge et
de contrôle de l’état des pneumatiques, cloison
de séparation dans les utilitaires, etc.
Un carnet d’entretien et d’utilisation dans
chaque véhicule permettra de contrôler la
régularité de son entretien et des diverses
interventions, et de recueillir les commentaires
des conducteurs sur d’éventuels problèmes
décelés lors de leur utilisation. Il faut
aussi prévoir de rappeler l’obligation pour
les conducteurs de respecter les dispositions
du Code de la route et de rappeler celles-ci
par le biais d’une information et d’un livret
disponible notamment à bord du véhicule.
Conclusion : développer la culture de prévention
De grande taille ou non, toute entreprise a
des obligations de sécurité vis-à-vis de ses
salariés. L’évaluation des risques présents
doit être préalable à la prise de mesures de
prévention et l’employeur doit constamment
chercher à améliorer la sécurité aussi
bien sur le site de travail qu’en intervention.
Pourtant, toutes les entreprises n’ont pas les
mêmes moyens pour sécuriser l’activité de
leurs collaborateurs. Dans ce cas, l’accompagnement
d’un intervenant extérieur en prévention
des risques professionnels est possible
et des aides de financement existent.
Il est également essentiel d’instaurer et de
développer une culture de prévention des
risques qui concernent tous les salariés. Si
au fil du temps des habitudes de travail se
sont créées et qu’il n’est pas toujours simple
de les changer et de faire évoluer les mentalités,
l’employeur doit cependant agir à
long terme, en veillant par exemple aussi à
l’intégration des nouveaux arrivants.
En partenariat avec l’Assurance Maladie,
l’INRS a publié en 2018, TutoPrév accueil
réparation automobile, un livret destiné à
accompagner l’intégration des nouveaux
arrivants, les jeunes en particulier qui
restent particulièrement vulnérables face
aux risques professionnels du fait de leur
manque d’expérience et en raison d’une initiation
préventive trop souvent sommaire.
Ce livret permet aux novices, à travers des
planches illustrées de trois environnements
de travail différentes (carrosserie-peinture,
réparation mécanique et service rapide),
de repérer les risques et, pour son chargé
d’accueil, de vérifier les connaissances du
nouveau collaborateur. Il pourra ainsi, le cas
échéant, prévoir d’améliorer ses lacunes via
l’information et la mise en place de mesures
concrètes d’actions de sensibilisation et de
formations éventuelles.
Stéphane Chabrier